Sonny Simmons, Fiercely Independent Alto Saxophonist, Dies At 87
Saxophonist
Sonny Simmons left an indelible impression on fellow alto player Steve
Lehman, who vividly remembers the first time he heard Simmons live: It
was 1997, Lehman was assisting drummer Pheeroan akLaff – on the faculty
at Wesleyan College at the time, where Lehman was a student – who had a
gig with Simmons that Lehman attended. The impact was immediate.
"He
was somebody who could bring people to their feet and make them shout,
just with his sound," Lehman writes in an email. "You hear it right away
and there's no faking it. That kind of clarity and vision for what you
want your instrument to do. And to move people in that way — with just
your sound and phrasing and the nuances of inflection — that's something
I'm still striving for."
Simmons
died last week at the age of 87. The cause of death remains unknown,
but his life is cause for considerable celebration. Although jazz has
established a place in academic and cultural institutions, it was and
largely still is an outsider's music, and Simmons was an outsider's
outsider. With two notable exceptions, his entire discography as a
leader took place on small, independent labels that were often based
overseas, yet he also played on Iron Man and Conversations two of Eric Dolphy's masterpieces.
As documented in Robert Brewster's 2003 film, In Modern Time,
Simmons spent a decade homeless, sleeping in a box and playing on the
streets of San Francisco. Yet he rebounded, catching the attention of
executives at Qwest Reords and putting out his best-known recordings, Ancient Ritual in 1994 and American Jungle in
1997, which featured a stellar ensemble of pianist Travis Shook,
bassist Reggie Workman and drummer Cindy Blackman Santana. He also
connected with saxophonist and composer Michael Marcus and formed the
Cosmosamantics, which released nine albums from 2001-13.
"I
loved his connection to Bird, and his innovative 'new way' to phrase
lines with a strong blues base, similar to Ornette Coleman's approach to
improvisation," said Marcus. "Sonny's style is so true to the blues
along with freedom, harmonic knowledge and an undeniable pure tone with
beauty."
Sonny Simmons was born Aug. 4,
1933 in Sicily Island, La. His parents were forced at gunpoint to
abandon their property when Sonny was six – in the documentary, he
describes his father hiding him behind a tree to avoid possible gunfire.
His family later moved to Oakland, California where Simmons took up
music, first playing the English horn then turning to alto saxophone at
16, thanks to the aforementioned inspiration of Charlie Parker. Simmons
began playing professionally shortly thereafter, but his career truly
took off when he moved to New York. He did sideman dates with Prince
Lasha and both men performed with Dolphy on his superb 1963 recordings, Iron Man and Conversations. He also joined drummer Elvin Jones and bassist Jimmy Garrison on Illumination in 1963.
Of Simmons work with Lasha, notably Firebirds, Lehman
says, "It's sort of smack-dab in the middle between the sound of
Ornette Coleman's small groups and Jackie McLean's small group
recordings with Bobby Hutcherson."
Simmons later began recording as a leader, too. He released Staying on the Watch (ESP) in 1966 and Music from the Spheres (ESP)
in 1968. Both were innovative musically and socially, as they featured
his wife Barbara Donald on trumpet, a rarity back then. Label Manager
Steve Holtje said of the recordings, "They're tonal but pushing tonality
to its limits, and using freer structures; they also have a soulfulness
that, if not 'spiritual jazz,' is in the next neighborhood over."
Following
his Qwest recordings, Simmons recorded regularly and gained some
recognition as a crucial voice during one of jazz's most innovative
times. Holtje said of Simmons lasting importance, "he could be held up
as an example to anti-free naysayers. He clearly had a strong bebop
background and could blow on changes when he wanted to. In that sense he
extended the legacy of Eric Dolphy, with whom he played, of sounding
free while also displaying solid standard techniques, and of playing at
the edge of harmony in his improvisations."
Marcus
added, "Sonny's contributions to the music are enormous. He lays in the
pantheon with the great innovators and masters of the music," he said.
"Sonny was more than just a musician, he was (and is) a messenger of
universal sounds that always had a prayer included."
Copyright 2021 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.
Vidéo In Modern Time: en Anglais la Vie de regretté Sonny Simmons
LE
BLUES DE SHEPP, C’EST AUSSI LE NÔTRE !
En juillet
2011, Archie Shepp
s’était produit au festival de Junas (près de Nîmes) et j’avais
alors rendu hommage à ce musicien (l’écoutant depuis près de 50
ans) avec un texte que j’avais intitulé Shepp,
Shepp, semper Shepp qu’on peut
lire sur http://jazzestla.blogspot.com
en fin de la rubrique « articles » ( des raisons
techniques ont fait disparaître le titre !). Deux jours après
avoir terminé cet article, j’appris la disparition du chanteur
Joe Lee Wilson
le 17 juillet 2011. Archie Shepp le connaissait bien pour avoir
enregistré ensemble par exemple en 1971 « Things Have Got To
Change », en 1977 « A Touch of the Blues » avec
Siegfried Kessler , Cameron Brown et Clifford Jarvis… J’eus
l’occasion l’après-midi du concert d’échanger quelques mots
avec Archie Shepp sur la disparition de ce chanteur que j’avais
bien connu. La programmation cette année de l’ « Attica
Blues Big Band » dans plusieurs festivals de l’été - comme
aux Carrières de Junas le 20 juillet 2018 - me donne l’envie à la
fois de revenir sur l’histoire de cette création et d’évoquer
la mémoire de Joe Lee Wilson qui justement fut l’un des chanteurs
de l’Attica des années 1972.

On ne peut
que se réjouir qu’Archie Shepp ait monté cette 3ème
édition d’Attica Blues Big Band en 2012 avec toute une nouvelle
équipe composée de musiciens de la génération actuelle mais
aussi d’amis de longue date comme le batteur de l’historique Art
Ensemble de Chicago, Famoudou Don
Moye, le
contrebassiste Darryl Hall
et le pianiste Tom McClung
qui, disparu en 2017, manque particulièrement douloureusement dans
la série de concerts de cet été. Shepp, à 81 ans, poursuit
inlassablement le chemin qu’il a emprunté dès le début de sa
carrière. Il convient donc de se souvenir du contexte de la création
de l’Attica Blues
enregistré par le célèbre label
Impulse en 1972.
En 1971 un
soulèvement de prisonniers éclate à la prison d’Attica dans
l’Etat de New York après l’assassinat du militant George
Jackson, membre des Black Panthers
(auquel Archie Shepp rend hommage dans l’un de ses titres). Une
répression violente menée sur ordre du gouverneur Nelson
Rockefeller fera des dizaines de morts sans compter les diverses
représailles que subirent les prisonniers pendant des semaines de la
part des gardiens tous blancs. Archie Shepp engagé comme de nombreux
autres musiciens de l’époque voulut marquer son indignation à
travers l’enregistrement de « Attica Blues » à peine
un an après les événements. Cri de révolte musical puisant à la
source de toutes les musiques populaires noires (blues, rythm’n
blues, soul, jazz…), l’œuvre originale étant fortement marquée
par l’émotion provoquée par les événements, mais aussi
finalement par tout un contexte de l’époque
car les épisodes douloureux furent nombreux.

La liste des
participants est symbolique puisqu’on y trouve nombre de musiciens,
figures clé du bouillonnement de cette période, oeuvrant chacun à
leur façon à la révolution free sur le plan musical et au combat
contre la ségrégation et le racisme encore bien vivaces. Tous ont
vécu au quotidien aux Etats-Unis les situations d’injustice
révoltantes. Plusieurs d’entre eux s’étaient déjà réunis aux
côtés des leaders du mouvement noir à Alger en 1969 lors du
célèbre Festival Panafrican voulant ainsi marquer le retour aux
origines africaines. On trouve ainsi dans « Attica Blues »
de 1972 : Clifford Thornton, Charles Greenlee, Marion Brown,
Leroy Jenkins, Dave Burrell, Jimmy Garrison , Beaver Harris, Cal
Massey…. Impossible de les citer tous. Pour beaucoup ils furent
longtemps de fidèles compagnons de route d’Archie Shepp, tous
imprégnés du climat de l’époque, tous animés par l’esprit de
révolte. Parmi eux, Joe Lee Wilson ! Il fut sans doute le
chanteur le plus à même de contribuer à ce projet. Imprégné de
la tradition du blues, avec un sens inégalé du swing, l’un des
rares chanteurs se produisant avec les musiciens du free jazz, Joe
Lee Wilson amplifie de son timbre puissant de baryton l’émotion
qui se dégage de l’ensemble de l’œuvre.

Je fis la
connaissance de Joe Lee Wilson dans les années 80 alors qu’il se
produisait en été à l’Alibi Jazz Club crée par Richard Bréchet
à Uzès. Hébergé chez des amis qui m’accueillaient aussi, nous
avons passé un après-midi à l’ombre d’arbres bienvenus à
discuter à bâtons rompus, étant pour ma part heureusement épaulé
par un ami plus doué que moi en anglais. L’échange fut d’emblée
des plus chaleureux, ce qui n’étonnera pas tous ceux qui ont connu
ce côté très avenant de l’homme. Mais Joe Lee sentait bien aussi
que nous partagions quelque chose d’important. Nous avions les
mêmes références musicales, moi en tant que simple amateur, lui en
tant que musicien. Les noms fusèrent : Coltrane, Ayler, Sunny
Murray, Mal Waldron, Elvin Jones, et bien sûr Shepp. Son visage
s’éclairait de bonheur à l’évocation de ces musiciens,
musiciens que pour ma part je connaissais principalement par les
albums ou concerts, mais que lui connaissait parfaitement pour s’être
produit avec eux ou pour les avoir fréquentés. En effet, avant de
s’installer en France, sa carrière lui avait fait partager la
scène avec Sonny Rollins, Miles Davis, Pharoah Sanders, Art Blakey,
Freddie Hubbard, Elvin Jones, Sunny Murray…. De quoi laisser
pantois l’amateur que j’étais ! Le ton devenait plus grave
à l’évocation de toute l’histoire de la bataille des droits
civiques, de la ségrégation indissociable à mes yeux de ce qui se
passait alors dans le jazz. Joe Lee comme tous les autres musiciens
de cette période avait plus d’un épisode à raconter s’étant
trouvé au cœur de cette situation. Originaire de l’Oklahoma, il
revendiqua d’ailleurs de plus en plus son origine Creek.

Installé en Europe
depuis 1977, partageant son temps entre Brighton et Paris, Joe Lee me
convia à venir l’écouter à Paris puisqu’ à l’époque je
vivais en Normandie. Ce que je ne manquai pas de faire et ce fut
l’occasion de quelques soirées mémorables en particulier au Duc
des Lombards qui était alors un club
moins fermé qu’aujourd’hui où l’on pouvait rencontrer nombre
de musiciens de la scène jazz qui venaient écouter ou jouer avec
les copains. Joe Lee s’y produisait en alternance avec son groupe
de Brighton ou avec les amis américains de Paris. Je pus ainsi
l’entendre avec Bobby Few ou Kirk Lightsey, le contrebassiste Jack
Gregg, le batteur Sangoma Everett, Georges Brown…. Il se produisait
aussi avec Tom Mc Clung, Harry Swift et avant sa disparition :
Ted Curson ! Autant dire qu’il a côtoyé tous les grands de
cette période très créative du jazz. Son répertoire était d’une
grande variété passant d’un blues entraînant comme Blues
Ain’t Nothing à une ballade
envoûtante comme Naïma
de Coltrane qu’il affectionnait particulièrement (donnant
d’ailleurs ce prénom à sa fille) poussant sa voix à l’extrême
pour clamer ce nom, ou encore plus rageur et captivant dans The
Shadow . Quelque soit le thème, sa
présence impressionnait, son visage ouvert et ses yeux brillants
d’humanité communiquaient la joie à tout l’auditoire. On tape
dans les mains, on chante. La voix est forte naviguant entre joie et
colère. Toutes les occasions que j’ai eues de l’entendre (et
elles furent assez nombreuses) furent vraiment de grands moments où
à chaque fois la joie était partagée entre tous.

Oui, Joe
Lee Wilson était bien la voix qu’il fallait pour Attica.
En 1979 il fut d’ailleurs à nouveau présent dans la deuxième
version qui cette fois-ci fut enregistrée en Europe par les soins de
Gérard Terronès.
L’arrivée de musiciens américains en Europe (certains
s’installant définitivement à Paris) permit cette réalisation
qui fut enregistrée en live au Palais des Glaces pour le label
Futura et Marge sans compter que son
leader Archie Shepp bénéficiait depuis plusieurs années d’une
reconnaissance bien méritée de la part du public en Europe et en
France en particulier. Gérard Terronès fut d’ailleurs à
l’origine de plusieurs albums d’Archie Shepp. On y trouve encore
nombre de musiciens phares du jazz de cette période : Marion
Brown, Charles Greenlee sont toujours là, mais aussi Steve Turre,
Clifford Jarvis, Roy Burrowes, Kamal Alim et bien d’autres. Bien
sûr aujourd’hui, la composition de l’orchestre ne peut plus être
la même (ne serait-ce que parce que certains ont malheureusement
disparu), le contexte n’est plus le même. Quoique ! Car en
effet, Attica
aujourd’hui garde sa pleine signification. Archie Shepp a toujours
été fidèle à son engagement. Les amateurs qui ont suivi son
parcours et ont connu les événements de toute cette période ne
peuvent que partager l’amer constat qu’il exprimait dans un
entretien avec Eric Delhaye pour Télérama le 5 juin 2018 dont je
reproduis ici une partie :


« Le monde entier
semble glisser vers des idées conservatrices. Cela vous
inquiète-t-il ?
Oui, et c’est
encore plus préoccupant aux Etats-Unis quand on observe les
positions de Donald Trump face à l’Iran, au conflit
israélo-palestinien ou aux questions environnementales, sans parler
de la politique intérieure. L’histoire fonctionne par cycles et
nous avons fait un grand pas en arrière.
En arrière jusqu’où ?
L’histoire
du jazz, la vie des musiciens, les conditions de création ont été
longtemps pour beaucoup un combat. L’expression musicale était le
plus souvent indissociable de l’aspiration à un monde plus humain.
Certains s’en sont écartés, en Europe et ailleurs, oubliant les
racines. Nombre d’organisateurs ou de responsables de lieux ont
gommé, consciemment ou pas, l’aspect contestataire de cette
musique pour se réfugier dans une politique comptable de
rentabilité. Qu’importe ! Toutes les absurdités du monde
d’aujourd’hui, ses atrocités, ses massacres, ses injustices et
inégalités ramènent à une certaine réalité pour qui s’en
préoccupe et tout cela donne une dimension particulière à Attica
Blues. Certains faits qu’on croyait
du passé reviennent au galop, certains propos qu’on pensait
dépassés ont libre cours, alors le jazz, celui qui vient des
origines, a encore fort à faire ! !
Merci
Mr Shepp, merci Mr Joe Lee Wilson, merci à tous les acteurs passés
et actuels pour cette œuvre historique.
Pour
ma part, pour bien des raisons, l'émotion sera forte lors de ce
concert du 20 juillet à Junas, mais je sais qu'elle sera partagée
par bien des amateurs et par les acteurs eux-mêmes de cette soirée.
Merci à l'équipe de Junas pour cette programmation exceptionnelle !
Patrice
Goujon le 11 juillet 2018
(
encore une fois, ce texte est écrit en toute modestie, il n’est
sans doute pas sans erreurs d’écriture, mais l’envie de rappeler
l’histoire d’Attica et d’évoquer la mémoire de Joe Lee Wilson
prévalait).
Le
concert Le Jazz Est Là du vendredi 6 avril à 21h au Domaine du
Prieuré d’Estagel suscitera, nous l’espérons, une mobilisation
du public à la hauteur de l’événement. Comme je l’ai souvent
expliqué lors de divers concerts, la programmation Le Jazz Est Là
est liée à ma longue histoire personnelle avec le jazz en tant
qu’amateur tout simplement, à des liens d’amitié tissés avec
le temps avec nombre de musiciens et à la fidélité envers des
musiciens que j’ai toujours admirés, sans compter au fil du temps
de nouvelles rencontres. La venue exceptionnelle de Barre Phillips
et de René Bottlang s’inscrit dans cette démarche. Si j’ai des
raisons particulières (que je souhaite évoquer ici) d’être ému
par cette soirée, il est probable que nombre d’autres amateurs qui
voudront bien me lire, trouveront quelques références qui les
renverront sans doute à leur propre mémoire et les plus jeunes
trouveront peut-être quelques éléments qui attireront leur
attention.

En
1969, encore lycéen, déjà passionné de jazz, j’assiste à mon
tout premier concert, un peu par hasard. En effet ouvrant le journal
local de Rouen, j’y trouve l’annonce d’un concert du
saxophoniste Marion
Brown
le soir même. Marion Brown ! C’était pour moi, l’un des
sax d’Ascension
de
Coltrane,
puis du Fire
Music d’Archie
Shepp
que les amateurs connaissaient déjà. Habitant encore chez mes
parents non loin du centre ville, je me rendis au concert à la Salle
Ste Croix des Pelletiers (ancienne église désaffectée) qui
deviendra peu de temps après le haut lieu de Rouen Jazz Action qui
nous offrit des concerts mémorables. Marion Brown était entouré du
vibraphoniste Günter Hampel, du batteur Steve Mac Call et du
contrebassiste…. Barre Phillips ! Concert que je n’oublierai
jamais, écoutant pour la 1ère
fois en direct des musiciens pour lesquels j’avais déjà beaucoup
d’admiration. Je connaissais le nom de Barre Phillips depuis le
célèbre album New
Thing at Newport
une face étant consacrée au quartet de Coltrane, l’autre à la
formation d’Archie Shepp qui y interprète le quasi historique Le
Matin des Noirs,
thème que j’écoutais inlassablement pour le son terrible de
Shepp, le jeu répétitif, envoûtant de Bobby Hutcherson, le jeu
subtil et inventif du batteur Joe Chambers et de…. Barre Phillips.
C’est dans la même période que sortit l’album Le
Temps
Fou
de Marion Brown (relativement
introuvable)
où figurent les acteurs de mon 1er
concert avec le trompettiste Ambrose Jackson. C’est aussi en
décembre 1969 que Gérard Terronès sort le premier album de son
Label Futura et Marge Live
at the Gill’s Club
avec le pianiste Siegfried Kessler, le batteur Steve Mac Call et
Barre Phillips (album
toujours disponible en CD).
L’année suivante, en janvier 70, c’est Alors !
Barre
étant aux côtés de Michel Portal, John Surman, Stu Martin et Jean
Pierre Drouet (album
toujours disponible en CD).
Période riche en créations, les revues spécialisées de jazz de
l’époque ne manquent pas de nous informer sur tout ce
bouillonnement. Je retrouve avec bonheur le numéro 260 de Jazz-Hot
(avril 1970) dans lequel Barre Phillips est interviewé sur 3 pleines
pages justement par Gérard Terronès qui collabora à cette revue
(propos au passage recueillis au magnétophone). En 1970, Barre y
évoque déjà des collaborations musicales…. passées : Jimmy
Giuffre, Paul Bley, Georges Russell, Lee Konitz…. Autant dire qu’il
a côtoyé quantité de musiciens de renom de la scène jazz.


Je
suivis donc le parcours de ce musicien, parallèlement à celui de
beaucoup d’autres car ils étaient nombreux à nous passionner. Ses
albums furent nombreux, impossible de tout citer (encore une fois
c’est Gérard Terronès qui produisit en France le fameux solo
Basse
Barre
(Journal Violone) premier solo de contrebasse de l’histoire du
jazz. Par la suite, les occasions manquèrent toutefois pour ma part
de réécouter Barre Phillips en concert. Une occasion quand même au
Havre, se produisant en solo avec la danseuse Carolyn Carlson avec
laquelle il travailla. Plus récemment, nouvellement arrivé à
Nîmes, c’est en concert avec le regretté Jean-Jacques Avenel que
je pus l’entendre dans la région. Je n’ai pu alors m’empêcher
d’évoquer avec lui ces moments antérieurs. Ceux qui étaient à
Paloma (à Nîmes) en 2016 n’ont pu oublier cet échange
exceptionnel avec le contrebassiste Marc Dresser qui dans une salle
aux Etats-Unis, grâce à une prouesse technologique, joua en direct
en duo en même temps que Barre Phillips. Il manque sans doute
beaucoup de choses sur le parcours de Barre, mais voilà ce que ce
musicien représente pour moi
René
Bottlang (qui rappelons-le enregistra entre autres un duo avec Mal
Waldron, et avec Charlie Haden) connaît de longue date Barre
Phillips. Le renom de ce pianiste m’était d’abord parvenu aux
oreilles il y a de nombreuses années alors que je venais écouter
quelques concerts l’été dans la région. Mais c’est installé à
Nîmes que notre rencontre ne tarda pas. Commençant à organiser des
concerts, je fus vite impatient de trouver l’opportunité d’inviter
René Bottlang. Plusieurs occasions se présentèrent pour notre plus
grand bonheur, savourant à chaque fois son jeu hors normes dans
lequel se glissent parfois quelques échos de Monk ou de Waldron,
références qui ne peuvent que nous ravir. Loin de toute
démonstration son jeu est toujours inventif, plein d’inattendu, de
beauté et de sensibilité. Dans le magnifique album sorti en 2011
Theatro
Museo,
(disponible
chez ajm!series)
il enregistre aux côtés du batteur Christian Lété et de Barre
Phillips. L’idée avance comme une évidence : faisons le
duo René Bottlang / Barre Phillips ! Un concert unique,
exceptionnel. Quel événement ! Barre Phillips 50 ans après
mon premier concert, avec l’ami Bottlang complice de longue date
avec Barre. Comment ne pas souhaiter partager cela avec le plus grand
nombre !
Alors,
pas d’hésitation, vendredi 6 avril, c’est là qu’il faut
être !
Patrice
Goujon 02 avril 2018
ALBERT AYLER…. un vrai festival !
Il y a 47 ans exactement, la
lecture des programmes des festivals de jazz me donna des frissons
nettement plus forts que celle des programmes d’aujourd’hui.
Ai-je vieilli ou les temps ont-ils changé, les grands circuits
commerciaux ayant fait leur travail ? En tout cas, le petit
provincial de Rouen que j’étais décida en 1970, à l’âge de 19
ans, de faire le voyage de Normandie en train de nuit (pas aussi
simple qu’aujourd’hui) pour me rendre à des concerts dans le sud
où se produisaient des musiciens qui faisaient déjà partie de ceux
qui me fascinaient : Archie Shepp et le Full Moon Ensemble à
Antibes, puis les concerts devenus historiques d’Albert Ayler et de
Sun Ra à la Fondation Maeght à St Paul de Vence. J’ai déjà
relaté dans mon texte « Shepp, Shepp, Semper Shepp » le
concert d’Antibes (sur http://jazzestla.blogspot.com). J’avais
promis de revenir sur ceux de St Paul de Vence. Le temps m’a
souvent manqué, parfois l’énergie, mais l’envie était toujours
vivace dans mon esprit d’évoquer le souvenir de ces concerts
fabuleux que d’autres ont aussi vécus et qui ont probablement
laissé chez beaucoup de grandes émotions. Ayant eu la chance d’être
présent à ces concerts, je souhaitais depuis un bon moment évoquer
le souvenir exceptionnel de ces soirées sur lesquelles les plus
jeunes trouveront peut-être de moins en moins les textes antérieurs
écrits à ce sujet par des critiques et des spécialistes, textes
finalement pas si nombreux que cela. J’ai croisé bien après cette
période plusieurs personnes qui avaient aussi vécu ces concerts. A
commencer par exemple tout simplement par Yoyo Maeght (venue
dédicacer son ouvrage « La Saga Maeght » au Carré d’Art
à Nîmes en 2015) que je n’ai pu m’empêcher d’aborder pour
évoquer ces soirées. Elle était alors une petite fille de 11 ans
qui assistait aux concerts organisés par… son grand-père auquel
elle rend hommage dans son livre. Elle aussi en gardait un souvenir
ému.

Déjà branché à la fin des
années 60 comme beaucoup d’autres sur la musique de John Coltrane,
la disparition de ce dernier en 1967, alors que nous avions déjà
écouté beaucoup de ses albums comme « Ascension »,
« Olé », « Live at the Village Vanguard »,
« Om »… ( même s’ils arrivaient en retard en Europe
et encore plus dans une ville de province comme Rouen où je
résidais), sa disparition laissa tous les amateurs de l’époque
perplexes sur ce qui pourrait se passer après. La disparition
antérieure d’Eric Dolphy en 1964 n’arrangeait pas les choses.
Coltrane avait marqué toute une génération de musiciens bien sûr,
mais aussi d’amateurs finalement nombreux. Dans le sillage de
Coltrane, il y avait bien entendu Pharoah Sanders présent dans
plusieurs albums et très marqué par l’empreinte de Coltrane, puis
Archie Shepp qui continuera sa route à sa façon, Marion Brown, John
Tchicai et bien d’autres. Ornette Coleman connu aussi depuis un bon
moment était aussi l’un des musiciens phares de cette période
Mais une autre voix s’élevait au milieu de ce bouillonnement de
l’époque : celle d’Albert Ayler. John Coltrane avait dit à
son sujet : « Albert Ayler m’est très proche. Je trouve
qu’il est en train de déplacer la musique dans des fréquences
encore plus élevées. C’est peut-être là où je me suis arrêté
qu’il commence, il a rempli un espace que je n’avais pas encore
touché. » °

1
Lecteur assidu dans ces
années des revues de jazz, j’y trouvais quelques références sur
Albert Ayler sachant qu’il se produisait aux côtés de Don Cherry,
Sunny Murray, Cecil Taylor, Gary Peacock, Alan Silva, musiciens dont
j’écoutais déjà la musique et dont les noms eurent rapidement
une forte résonance en Europe. Le numéro 3 de la revue Actuel
acheté en 1969 avec la célèbre couverture avec Don Cherry me
régalait de tout ce qui me passionnait : article sur Sunny
Murray, Chris Mc Gregor, poèmes de Sun Ra…. . Les disques de ces
musiciens arrivaient au compte-goutte à l’époque, en particulier
en province où il fallait encore qu’il y ait un disquaire ouvert à
ce courant musical assez maudit pour se les procurer. Tout jeune
étudiant, j’avais l’habitude de me rendre au « Record
Shop », petit disquaire à Rouen où nous pouvions écouter
dans des cabines des extraits des disques. J’y passais beaucoup de
temps à écouter les disques des Labels « BYG », « IMPULSE »,
« ATLANTIC » et c’est là finalement que j’ai
commencé ma collection. C’est là aussi que j’achetai mon
premier disque d’Albert Ayler « Live at Greenwich Village »,
puis « Music is the Healing Force of the Universe» dans
lequel se produisait le pianiste Bobby Few l’ami d’enfance
d’Ayler, ayant grandi tous deux à Cleveland, nés respectivement
en 1935 et 1936. Il y avait donc bien déjà d’autres amateurs
comme moi qui connaissaient Albert Ayler et non pas seulement un
petit groupe d’initiés parisiens comme j’ai pu le lire quelque
part. Simplement nous étions en province et étudiants, nous
n’avions souvent pas les moyens de suivre les concerts de la
capitale ni d’acheter tous les albums qui nous faisaient rêver. Le
public d’ailleurs nombreux à St Paul de Vence n’est pas sorti de
rien. Beaucoup savaient que ces concerts étaient exceptionnels,
beaucoup attendaient avec impatience de pouvoir enfin écouter en
direct ces musiciens qui, nous n’en doutions pas, constituaient
l’avant-garde du moment.

L’annonce des concerts des
Nuits de la Fondation Maeght : deux concerts Albert Ayler, deux
concerts Sun Ra, me poussa donc à trouver tous les moyens pour m’y
rendre (deux autres concerts prévus furent annulés avec… Milford
Graves !). Accueilli dans la famille d’un copain de lycée à
Nice, pour me rendre au concert du 25 juillet je pris un car pour St
Paul de Vence. Découverte d’un beau village provençal, déjà un
peu défiguré, mais moins qu’aujourd’hui. Pour se rendre à la
Fondation Maeght, il faut monter une petite pente vers un espace
arboré entre cyprès et autres espèces au milieu des essences
provençales. La bonne chaleur du soir se mêlait à l’excitation
du moment qui m’attendait. C’était une occasion unique
d’entendre Albert Ayler qui n’était pas venu en France depuis
1966 pour un concert parisien où il avait reçu un accueil très
mitigé proche du scandale. A côté du bâtiment de la Fondation
Maeght inauguré en 1964 par André Malraux, où le propriétaire,
mécène, Aimé Maeght accueillait de nombreux artistes comme Joan
Miro, Alexander Calder,
Fernand Léger, Alberto Giacometti, George
Braque… une immense structure gonflable en
chlorure de vinyle orange et blanche
conçue par Hans-Walter Müller avait été installée pour les
concerts. Gonflée sous pression de l’air en 10 minutes, cette
structure plantée en pleine nature dans le site permit d’accueillir
plus de 1000 personnes chaque soir. L’atmosphère du lieu, la
surprise créée par l’impressionnante structure, le nombreux
public qui affluait, tout cela contribuait à augmenter la tension de
l’avant concert : j’allais entendre en direct et pour la
1ère fois Albert Ayler, Albert Ayler déjà écouté et
réécouté avec ses albums, Albert Ayler l’avant-garde qui se
profilait. Il y eut deux concerts les 25 et 27 juillet 1970.
Impossible de décrire la musique, mieux vaut écouter les deux
traces sonores au travers des deux albums du Label « Shandar »
enregistrés par les soins du regretté Daniel Caux°°. (A noter que
les thèmes des deux albums sont extraits uniquement du 2ème
concert sans doute à cause d’un fait qui, par contre, fait
bizarrement défaut dans ma mémoire : un article rappelait que
le pianiste ne fut présent qu’au 2ème concert).

2
Quelques mots malgré
tout : l’ambiance fut exceptionnelle. Ayler mêle comme il
sait le faire les envolées les plus free à des passages d’un
lyrisme déchirant qui emporte le public. C’est un son de groupe,
un son d’ensemble qui emplit la salle, auquel Mary Maria contribue
avec sa voix émouvante et très soul, empoignant même à plusieurs
reprises un sax soprano. Entre ses interventions, assise sur une
chaise, dans une tenue blanche simple, elle ne quitte des yeux les
évolutions de son compagnon. Elle doit mesurer à sa façon ce qui
est en train d’arriver car le public adhère très rapidement
manifestant sa joie par des applaudissements répétés après chaque
thème. La joie est visiblement partagée de la façon la plus
inattendue. Albert Ayler jette des regards répétés vers sa
compagne affichant le bonheur de l’instant. Tout le groupe est
visiblement emporté par cet accueil inespéré. Plus de 1000
personnes applaudissent à tout rompre la prestation. Je n’avais
jamais assisté à un tel engouement. Les thèmes s’enchaînent
sans relâche, la tension ne baisse pas, l’émotion semble ne
pouvoir jamais s’arrêter. Les applaudissements des albums ne sont
pas fabriqués, les rappels semblent ne jamais pouvoir s’arrêter
et les musiciens ont eux-mêmes bien du mal à stopper ce bonheur
partagé. Je n’exagère rien, tous les participants à ces soirées
vous le confirmeront. A la sortie, tout le monde arbore un sourire de
franche satisfaction. Je ne me souviens plus de mon retour sur Nice,
mais le récit que je fis le lendemain à mes hôtes (pas
spécialement amateurs de jazz) les décida à venir au 2ème
concert, 2 jours plus tard. Je leur ai probablement transmis une
grande part de mon émotion : ils ont craqué !
Un peu inquiet de ce que pourrait
être leur réaction - ces gens-là n’avaient pas du tout
l’habitude de cette musique- j’étais malgré tout assez
confiant. Mes problèmes de transport furent donc réglés puisque
mes hôtes m’emmenaient avec leur voiture. Etant niçois, St Paul
de Vence, la nature environnante, la Fondation Maeght ne
constituaient pas pour eux l’effet de surprise qui fut le mien
venant pour la première fois dans cette région. Par contre
l’installation de la structure les impressionna comme ce fut le cas
d’ailleurs pour tout le public en général. Puis vint la musique.

Beaucoup comme moi étaient revenus au
2ème concert. Les acharnés, les inconditionnels. Nous
mesurions le côté exceptionnel de ces concerts. L’avenir nous
prouva que c’était bien le cas. C’est l’ovation dès l’entrée
en scène comme si nous ne nous étions à peine quittés depuis le
concert précédent. La musique ne faiblit pas. On sent bien que les
musiciens sont imprégnés du succès d’avant. Au piano Call Cobbs,
fidèle compagnon, (qui se permet de jouer du clavecin dans l’album
«Love Cry » avec Milford Graves à la batterie et Alan Silva à
la contrebasse entre autres…) au look d’un vieux monsieur très
classe, costard cravate, lunettes noires, capable de toutes les
audaces au piano avec un jeu très poétique qui tranche avec celui
plus strident d’Ayler tout en s’y mêlant parfaitement, à la
batterie Allen Blairman (qui au passage enregistra aussi avec Mal
Waldron) assure sans chercher d’effets particuliers un jeu d’une
efficacité redoutable avec une présence permanente, Steve Tintweiss
complète la formation à la contrebasse avec la plus grande
harmonie. Tous jouent sans relâche avec une énergie débordante.
Les flots de masses sonores allant parfois au maximum de ce qui est
possible d’intensité alternent avec des accalmies où chacun livre
ce qu’il y a de plus subtil dans son jeu. Mes amis sont très vite
conquis emportés par la liesse générale. Les solos d’Ayler sont
souvent « le cri » mais le « Love Cry » titre
de l’un de ses albums antérieurs. Emouvant, déchirant, lyrique !
Le sax pousse le son à l’extrême, mais c’est lui qui se livre
totalement emportant le public dans le sillage de ses émotions. Pour
beaucoup on ne connaissait Ayler que par les disques qui nous
permettaient de découvrir déjà un son unique comme dans la fameuse
version de « Summertime » avec Gary Peacock et Sunny
Murray. Nous connaissions plusieurs de ses compositions, mais la
formation pour ces concerts fut nouvelle et le plaisir d’entendre
en direct celui qui pour nous ouvrait une nouvelle voie du jazz fit
de ces soirées un moment exceptionnel. Mary Maria donne toute son
énergie dans un final d’un lyrisme époustouflant avec le célèbre
« Music Is The Healing Force of The Universe » que le
pianiste 3
Bobby Few se plaît à jouer encore
souvent aujourd’hui. Une fois de plus les applaudissements furent
interminables (comme en témoigne les albums), on ne compte plus les
rappels. Mes hôtes furent ravis, tout le monde sortit la mine
épanouie. Tous, nous avions vécu quelque chose d’inoubliable.
Nous quittions ces concerts avec la conviction que dorénavant nous
aurions davantage d’occasions qu’auparavant d’écouter à
nouveau ce musicien qui venait de conquérir le public en France.
Quelques mois plus tard, ces
soirées prirent pourtant brutalement une dimension particulière
avec la disparition tragique du saxophoniste, Albert Ayler quittant
le monde en se noyant dans les eaux de l’East River à New-York le
25 novembre 1970. La nouvelle fut terrible pour les amateurs de jazz
qui connaissaient sa musique. Elle émut particulièrement, on
imagine bien, le public qui l’avait acclamé quelques mois
auparavant lors des célèbres soirées à la Fondation Maeght. Le
saxophoniste maudit, souvent incompris durant des années,
disparaissait après l’accueil triomphal du public en France,
premier grand véritable succès de sa carrière. Derniers concerts
en Europe, derniers albums du saxophoniste. La nouvelle voie qu’on
voyait se dessiner dans le jazz était privée de l’un de ses
musiciens phares. De nombreux saxophonistes se révélèrent avoir
été déjà très influencés par ce son qui était propre à
Albert Ayler et ils poursuivirent à leur façon dans son sillage.
Mais Albert Ayler allait manquer ! Une bonne partie du public de
l’époque ne peut avoir oublié ces soirées – enfin je
l’espère !- Pour ma part, chaque écoute aujourd’hui de ces
albums s’accompagne du souvenir de l’ambiance qui fut celle du
direct. Le souvenir et l’émotion sont intacts. C’est ce que j’ai
tenté de faire partager avec ce simple récit.

Après ces concerts de fin
juillet 1970, c’en était pas fini avec les chocs musicaux puisque
les 3 et 5 août, c’est le Sun Ra Arkestra qui était programmé.
Mes amis conquis par la révélation d’Albert Ayler voulurent me
suivre et entraînèrent d’autres amis. A coup sûr, une plongée
dans la musique de l’Arkestra, c’était un choc assuré ! Il
y avait de quoi être enthousiaste, car il s’agissait de la
première tournée européenne de cette formation dont nous
connaissions déjà quelques albums. Sun Ra pour 2 concerts !
Cela ne s’oublie pas non plus, mais un peu de répit, j’y
reviendrai plus tard. Sachez que ce sera pour transmette une émotion
aussi intense que celle que m’avaient procurée les concerts
précédents tout en rendant hommage à un musicien longtemps aussi
décrié par certains, à tort et pour lequel j’ai eu et conserve
une admiration partagée par beaucoup d’amateurs.
Patrice Goujon 22 juillet 2017
(Ce texte est écrit en toute modestie, sans prétention. Il
comporte sans doute certaines erreurs d’écriture. Il s’agit pour
moi de rendre simplement hommage à un musicien qu’il ne faut pas
oublier et de donner à ceux qui sont nés plus tard une part du
parfum de cette époque).
° extrait de la 1ère page
du livre Albert Ayler « Témoignages sur un Holy Ghost »
ouvrage édité sous la direction de Frank Médioni éditions Le mot
et le reste qui regroupe de nombreux témoignages de musiciens qui
ont joué avec lui, l’ont fréquenté ou écouté ainsi que de
divers acteurs du monde du jazz.
°° Daniel Caux, disparu en 2008, fut
rédacteur à Jazz-Hot, animateur d’émissions de jazz et de
nombreuses autres émissions musicales sur France Musique et France
Culture dont le célèbre « Atelier Musical de Création
Radiophonique ». Il fut le directeur artistique du label
Shandar. C’est lui qui signe magnifiquement le texte de
présentation sur les deux albums d’Albert Ayler. Il fut très vite
avec quelques autres parmi les plus sincères défenseurs d’une
avant-garde que bien d’autres mirent du temps à accepter, il en
resta toute sa vie un fidèle défenseur et un témoin enthousiaste.
4
Chapeau, Mr Terronès !

Le Jazz Est Là a souhaité reproduire
l’interview de Gérard Terronès « Les dessous du doulos »
réalisée par la revue DJAM en août 2015 car le travail qu’il a
accompli au service du jazz est considérable : fondateur du
Label indépendant Futura Marge en 1969 et organisateur de nombreux
concerts dans des lieux historiques de la capitale, à commencer par
le Gill’s Club. Rappelons que vous pouvez consulter la liste de ses
productions avec le lien Futura-Marge qui figure sur notre blog.
Commentaire de Le Jazz Est Là :
Nous reproduisons cet article car Gérard Terronès y exprime l'essentiel de ce qui fut le fil conducteur de son combat en faveur du jazz, ligne qu'il ne quittera jamais. Avec une carrière derrière lui de déjà près de 15 ans à l'époque, Gérard Terronès se lance alors comme toujours dans un nouveau projet qui sera suivi de bien d’autres, devant surmonter à chaque fois tous les obstacles et les entraves qui n'ont pas manqué sur son parcours. Il a lutté avec ce même esprit toutes ces dernières années loin des courants dominants. Nous ne l'oublierons pas !

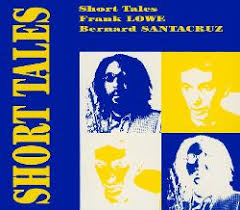
DE
FRANK LOWE A….. BERNARD SANTACRUZ
Dans
les années 70, habitué des concerts de Rouen Jazz Action qui
accueillait tous les grands représentants de ce qu’on appelait
alors le Free Jazz ou New Thing, j’assistai en 1976 au concert d’un
saxophoniste, trop peu connu : Frank Lowe. Pour ce concert, il
était entouré du trompettiste Lawrence Butch Morris, du batteur
George Brown et du contrebassiste Didier Levallet aujourd’hui seul
survivant de cette formation. Butch Morris, qui enregistra aussi avec
David Murray et bien d’autres, disparut en 2013. Il se produisit
d’ailleurs avec celui-ci et le contrebassiste sud-africain Johnny
Dyiani et George Brown en 1978 toujours dans cette vieille église
désaffectée de la ville de Rouen : la salle Ste Croix des
Pelletiers. George Brown formidable batteur, méconnu, s’installe à
Paris durant plusieurs années. Il m’arrivait de le croiser à
l’époque où le Duc des Lombards était un petit bistrot, tout en
longueur, où l’on rentrait, entrée libre, prendre un verre au
comptoir pour écouter les musiciens serrés au fond. Il y avait
souvent Bobby Few (piano), Suliman Hakim (sax), Jack Gregg
(contrebasse) et parfois George Brown toujours à l’affût d’un
boulot parce que ça n’était jamais facile. On ne trouve presque
rien sur ce musicien qui pourtant enregistre en 2002 avec Sonny
Simmons et Jean-Jacques Avenel l’album « Live in Paris ».
Des extraits du concert Frank Lowe furent donc gravés par Gérard
Terronès dans l’album « Tricks of the Trade ». Ce
saxophoniste m’avait marqué, mais il n’était pas facile à
l’époque de se procurer les enregistrements. Et il n’était pas
possible non plus d’acheter tout ce qui était produit. Il était
aux côtés des plus grands représentants de l’avant-garde de
l’époque. Citons quelques noms que nous avons plaisir au passage
d’évoquer pour raviver la mémoire : Joseph Jarman sax, Billy
bang violon, Joe mc Phee sax, Olu Dara trompette, Phillip Wilson
drums, Rashied Ali avec lequel il enregistre un duo en 1973, Don
Cherry avec « Brown Rice » en 1975, Charles Tyler
sax avec lequel enregistrent également Bernard Santacruz et Rémi
Charmasson, Wilbur Morris contrebasse (frère du trompettiste Butch
Morris)…..
Quelques
années plus tard, au hasard des pages d’un catalogue du Label Bleu
Regard, je tombe sur l’album « Latitude 44 » dans
lequel se trouve Frank Lowe, le batteur Denis Charles que je
connaissais pour ses collaborations avec Archie Shepp, Cecil Taylor,
David Murray … et le percussionniste africain Cheikh Tidiane Fall
qui avait déjà enregistré en 1979 avec Bobby Few et le regretté
Jo Maka (saxophoniste). C’est décidé, je commande l’album, avec
ces gars-là, ça doit être bon, même si je ne connais pas le
contrebassiste. Et, s’il joue avec eux, c’est qu’il est bon.
D’emblée je fus frappé par le jeu de la contrebasse qui n’était
pas sans évoquer celui des plus fameux de l’avant-garde que
j’écoutais. Ceux dont parle Bernard Santacruz dans l’interview
de l’époque que nous reproduisons : Fred Hopkins, Henry
Grimes…. Mais il ne s’agissait pas pour le contrebassiste Bernard
Santacruz d’une rencontre éphémère : suivirent les albums
« After the Demon’s Leaving » en 1997 et le duo « Short
Tales » en 2000 dont nous reproduisons la critique (rubrique
« critiques d’époque »). Frank Lowe disparut en 2003,
période où je m’installai dans la région.
Quelques
mois après mon arrivée à Nîmes, je me rendis à l’un des
concerts de l’AJMI à Avignon, association un peu parallèle dans
son esprit à ce qu’avait été pour moi Rouen Jazz Action. C’est
là que je rencontrai pour la première fois le contrebassiste de
« Latitude 44 » dont j’avais ignoré le lieu de
résidence. Je ne mesurai pas alors que sa collaboration avec Frank
Lowe venait juste d’être interrompue par la disparition de
dernier. Très vite je m’aperçus que, si je n’étais pas
musicien, nous avions beaucoup de références musicales communes.Dès
que je me mis à organiser des concerts, il était clair que je ne
manquerai pas l’occasion d’inviter celui que j’avais découvert
aux côtés de Frank Lowe. Je souhaitais des rencontres avec des
musiciens du même courant musical : ce fut le cas pour notre
plus grand bonheur avec John Tchicai, Bobby Few, Rasul Siddik et
Ernest Dawkins. Parallèlement je découvris la richesse des
collaborations de Bernard Santacruz qui depuis longtemps avait
ouvert, avec tout un réseau de musiciens amis que je découvrirai,
une voie large d’aventures possibles : la prochaine étant la
venue de son quartet « Migrants » en janvier 2015,
évènement marquant pour ce début d’année.
(Vous
pouvez commander auprès de Le Jazz Est Là les albums cités ainsi
que l’album solo.)
Patrice
Goujon le 15 janvier 2015

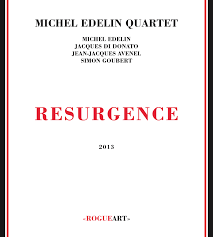
Jean
Jacques Avenel : nous ne l’oublierons pas !
L’Association
Le Jazz Est Là est très touchée comme nombre d’amateurs de jazz
et de musiciens par la disparition du contrebassiste Jean Jacques
Avenel décédé le 12 août. Nous aurions dû le recevoir lors de
deux concerts récents de notre Association en novembre 2012 avec le
trio « Kuntu » aux côtés de Michel Edelin, John Betsch
ainsi qu’en mai dernier avec « Résurgence » (Michel
Edelin, Simon Goubert et Jacques Di Donato), ses deux derniers
enregistrements chez RogueArt. Mais luttant déjà depuis longtemps
contre la maladie, il n’était plus en mesure de toucher à sa
contrebasse qui a vibré tant de fois dans de multiples concerts et
de multiples enregistrements. Le président de Le Jazz Est Là,
originaire de Rouen, avait très vite entendu parler de ce musicien
par des copains étudiants qui venaient du Havre, (ville près de
laquelle est né Jean Jacques Avenel) et qui l’avaient fréquenté
au lycée : « Je retrouvais les copains du Havre aux
concerts de Rouen Jazz Action que nous suivions assidûment dès
1972. C’est à ce moment qu’eut lieu la rencontre avec Steve Lacy
au Havre (relatée par Jean Jacques Avenel lui-même dans l’interview
Jazz Magazine de mars/avril 1978 – que nous reproduirons dans notre
rubrique « articles »). M’installant un peu plus tard
au Havre, le jeune contrebassiste qui avait d’emblée laissé sur
place une solide réputation avait déjà filé à Paris, pour aller
rejoindre l’avant-garde dans laquelle il occupa une place de choix
et à laquelle il restera fidèle. Il rencontre alors Noah Howard, le
quartet Frank Wright, il est aussi avec François Tusques autre
figure du courant de l’époque, courant auquel nous adhérions
totalement. Et le copain Avenel rejoint Steve Lacy, quelle histoire !
Une histoire qui allait durer plus de 25 ans et que nous avons suivie
jusqu’à la fin ».
Dans
cette longue aventure, qui fait faire au quintet le tour du monde des
clubs et des festivals, sont présents les complices de toujours
Bobby Few, John Betsch, Steve Potts musiciens que nous avons eu le
bonheur de recevoir à plusieurs reprises à Nîmes. Le
contrebassiste est avec Bobby Few et John Betsch dans l’album
« Flowers around Cleveland » du saxophoniste David Murray
en 1995, avec Steve Potts et Betsch dans l’album « Lonely
Woman » de la pianiste Claudine François en 2004. Ses
collaborations sont nombreuses car pour beaucoup de musiciens, c’est
un ravissement de bénéficier de son jeu exceptionnel. Ses
rencontres se multiplient comme par exemple avec le saxophoniste
Sonny Simmons et le regretté et trop peu connu George Brown à la
batterie dans « Live in Paris » en 2002 ou encore avec
« DAG » trio avec Simon Goubert et Sophia Domancich. Et
cela continue, impossible de tout citer ! En 2002, il enregistre
quasiment le dernier album du pianiste Mal Waldron dans lequel la
contrebasse laisse transparaître l’émotion forte de ce moment
musical exceptionnel auquel se joint partiellement Steve Lacy :
« One More Time » (voir notre rubrique « Critiques
d’époque »).
« En
février 2000, avec les copains havrais, c’est les retrouvailles
avec Jean Jacques de passage dans sa ville natale pour un concert en
trio avec Lacy et Betsch au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Ambiance chaleureuse. Concert magnifique, la contrebasse a encore
chanté de façon bouleversante comme toujours. La conversation se
prolonge dans le hall après le concert, moment bref pour raviver
quelques bons souvenirs. Nous connaissons bien l’itinéraire des
trois musiciens qui sentent notre passion. L’échange est des plus
chaleureux, à l’image du bonheur musical dans lequel nous venions
d’être plongés. Ce sera pour la plupart d’entre nous notre
dernier concert Steve Lacy qui disparaîtra en 2004 ». Après
sa disparition, le groupe Potts, Avenel, Few, Betsch lui rendra
hommage par une série de concerts. Aujourd’hui, c’est un autre
pilier de cette formation historique qui va manquer. Partageons ces
propos écrits récemment par Michel Edelin : « Il nous
reste les témoignages sonores de son génie musical, l’exemple de
son exigence artistique, le souvenir de sa fidélité en amitié,
d’un humour à fleur de peau et d’une inflexion de voix colorée
d’une pointe d’accent havrais par laquelle il savait dire
l’essentiel en quelques mots … »
Oui, Jean
Jacques Avenel n’a rien fait à la légère. Pas un enregistrement
dans lequel son jeu ne soit magistral. Ecoutez l’introduction
renversante de « Blues for JJ’S Bass » dans le « One
More Time » de Mal Waldron, écoutez l’introduction
émouvante, toute à l’archet de « Goût Bulgare » dans
le trio « Kuntu » de Michel Edelin. Ecoutez !
Ecoutez et faites écouter Jean Jacques Avenel puisque c’est notre
seul moyen aujourd’hui de l’entendre.
Patrice
Goujon le 17 août 2014
«
CHARLIE HADEN ? Merde ! »
Depuis
un moment l’idée me poursuivait d’écrire quelques souvenirs à
propos de la musique de Don Cherry notamment à l’occasion du
festival de Junas qui s’ouvrira le 23 juillet prochain avec
l’Hommage à Don Cherry initié par Doudou Gouirand et Michel
Marre, programme que Le Jazz Est Là avait eu l’occasion de
proposer à deux reprises au public de Nîmes avec à chaque fois un
grand succès. Une rencontre fortuite avec une amie amatrice de jazz
sur le marché du Jaurès nous amène à évoquer le nom de quelques
musiciens qui furent, pour beaucoup d’amateurs, ceux d’une grande
époque : Ornette Coleman, Don Cherry, on parle aussi de Steve
Lacy… Oui, quelle période ! Il faut que j’écrive sur Don
Cherry. Quel bonheur que des musiciens comme Doudou Gouirand et
Michel Marre se souviennent en musique, à leur façon, de celui
qu’ils ont connu, en particulier Doudou qui fut très proche de Don
Cherry, ce dernier enregistrant même sur une face de l’album de
Doudou Gouirand « Forgotten Tales ». Sur la pochette de
l’album enregistré en 1985, Pierre Lapijover commente: « La
face B commence avec l’inimitable son de trompette de Don Cherry
sur sa composition « World Music Suite », suite en 5
parties, où l’on peut retrouver l’ensemble de traditions
musicales chères au trompettiste : racines du gospel (après
l’introduction basée sur le –Welcome- de Coltrane), musique
orientale égrenée sur l’accordéon de Salis, le Brésil que
souligne le chant de Gouirand, l’Extrême-Orient avec une mélodie
méditative illuminant la voix et la trompette de Cherry, et ponctuée
par les guitares de Pansanel et Dorge et le soprano de Gouirand ».
L’hommage,
Michel Marre et Doudou Gouirand (qui évoluent loin des courants
dominants), le rendent finalement à travers une grande partie leur
carrière marquée par le souffle nomade et l’esprit de liberté
qui imprégnaient aussi la musique de Don Cherry. Michel Marre se
produit et enregistre avec des musiciens du monde, citons « Indians
Gavachs » à la suite d’une rencontre avec des musiciens du
Rajasthan, « Mindelo » big band avec crotales, djembe,
tablas ou congas, Doudou avec « Les Racines du Ciel »
côtoie l’Afrique, l’ambiance cubaine avec « Boleros »
L’un et l’autre pour finir se retrouvent, entre autres, avec John
Tchicai dans le magnifique « New Jungle Orchestra »
conduit par Pierre Dorge qui rend souvent hommage au contrebassiste
sud-africain Johnny « Mbizo » Dyani qui fut longtemps
dans l’orchestre. C’est tout cela aussi que ravive le quartet
« Hommage à Don Cherry ». La date du concert approche,
je dois parler de Don Cherry, certains passages musicaux que je
connais par cœur défilent dans ma tête, les souvenirs remontent…
Le
lendemain même de ma conversation sur le marché, un ami me prévient
de la disparition de Charlie Haden. Réponse rapide par mail :
« Merde ! ». Le Jazz Est Là ne fait pas à chaque
disparition un article, même si à plusieurs reprises l’envie
était forte comme pour Siegfried Kessler, Joe Lee Wilson, Byard
Lancaster, Paul Motian, Ted Curson, Horace Silver… Charlie Haden !
Charlie Haden au moment où raconter Don Cherry m’occupe l’esprit.
Dans notre rubrique « Critiques d’époque », nous
avions déjà sélectionné le disque du célèbre « Libération
Music Orchestra » disque fondamental, à plus d’un titre, de
cette période dont les arrangements furent l’œuvre d’une autre
artiste phare de l’époque et que nous admirons toujours :
Carla Bley. Tout le temps que je pensais à Don Cherry ces jourss-ci,
Haden était là évidemment aussi, et Ed Blackwell, et Ornette….
Charlie Haden est mort ! Je dois parler de Don Cherry et de
Charlie Haden .
C’est
bien avec la célèbre formation d’Ornette Coleman que Don Cherry
et Charlie Haden gagnèrent d’emblée une solide réputation auprès
des amateurs de l’époque Ce fut pour ma part d’abord à travers
les enregistrements, qui je le rappelle, arrivaient au compte-goutte
(et souvent bien après leur sortie américaine), dans les bacs d’un
disquaire d’une ville de province à condition encore qu’il ne
soit pas hostile à ce qu’on commençait à appeler le free jazz.
C’est justement l’historique album « Free-Jazz »
d’Ornette Coleman qui rentra dans ma discothèque. Mais je ne pus
me procurer l’album sorti en 1961 que 7/8 ans plus tard, à
l’approche de mes vingt ans. La pochette s’ouvrait sur « White
Light » de Jackson Pollock. Quant aux musiciens, la liste est
celle de tous ceux qui eurent droit à notre admiration pendant de
longues années et que pour certains nous connaissions déjà et
qui disposaient, bien que souvent plutôt jeunes, d’une belle
notoriété: Eric Dolphy, Freddie Hubbard, Scott LaFaro, Billy
Higgins, Ed Blackwell, Ornette Coleman et… Don Cherry et Charlie
Haden. Cette longue improvisation indiquait la voie nouvelle qui
allait s’ouvrir durablement pour le jazz. Ce grand bouleversement
musical eut sa réplique quatre ans plus tard avec le « Ascension »
de John Coltrane où se produisaient là aussi les futurs maîtres de
cette nouvelle école. Sur la pochette intérieure de l’album
« Free Jazz », le Label Atlantic imprimait la liste de
ses autres productions. La liste des achats espérés était donc
sous mes yeux avec des titres évocateurs qui ne pouvaient que
ravir les jeunes comme moi, emportés par la tourmente sociale de
mai68 : Ornette Coleman : « Something Else »,
« Tomorrow is the Question », « Change have to
Come », « This is Our Music », « Change of
the Century », « The Shape of Jazz to Come »,
albums à travers lesquels se forgèrent le style et la réputation
de Don Cherry et de Charlie Haden. Mais n’oublions pas que ces
enregistrements s’effectuèrent entre 1958 et 1961. Rappelons aussi
que Don Cherry fut aux côtés de Sonny Rollins en 1962 ( Our Man in
Jazz ), d’Archie Shepp et de John Tchicai en 1963 dans le New
Contemporary Five, d’Albert Ayler et Sunny Murray en 1964 (Ghosts)
et de John Coltrane avec Ed Blackwell et Charlie Haden en 1966 ( The
Avant-Garde). Cette grande communauté musicale à l’esprit libre
et profondément humain favorisa l’émergence de talents
prestigieux. Trop jeune à l’époque de tous ces albums, je ne pus
les découvrir qu’ultérieurement. Mais le succès grandissant des
musiciens américains en Europe contribua sans doute à
l’accélération de la diffusion des disques que nous commencions à
nous procurer, du moins, lorsque nos moyens d’étudiant nous le
permettaient. Ce fut le cas avec deux albums remarquables que Don
Cherry produisit plus tard sous son nom, alors que je le considérai
déjà comme un de mes musiciens favoris : « Symphony for
Improvisers » (1966) et « Eternal Rythm »
(enregistré au festival de Berlin en 1968), albums dans lesquels Don
Cherry confirmait au cornet son jeu chantant, mélodique, souvent
déchirant et bouleversant d’un lyrisme empreint tout à la fois de
nostalgie et de joie. Les écoutes répétées que je fis de ces
albums dès leur acquisition me gravèrent des passages entiers dans
la tête. Aujourd’hui, les réécouter me produit les mêmes
émotions. Pas question d’écouter des extraits, il fallait
consacrer 30 à 40 minutes d’écoute pour se concentrer sur ces
créations, longue improvisation à l’image de « Free Jazz »
ou d’ « Ascension ». L’ esprit nomade de Don
Cherry lui fit parcourir le monde d’où il ramena des sons, des
instruments, des mélodies comme avec les gamelans de Java et de Bali
dans « Eternal Rythm » et sans doute un style de vie à
la recherche d’une certaine sérénité blessée par les violences
et les déchirements du monde. Je laisse le soin aux amateurs d’aller
découvrir la liste des musiciens des deux albums cités, souvent
compagnon de route de longue date de Don. Tous ont occupé une place
primordiale sur la scène internationale du jazz.


Après
la longue complicité dans le quartet d’Ornette Coleman, Charlie
Haden va lui aussi mener sa route sans s’éloigner pour autant de
ses compagnons de toujours. Avec le fameux « Liberation Music
Orchestra » (voir notre rubrique critique d’époque), il est
avec Don Cherry, Ed Blackwell , Paul Motian, Dewey Redman…..
musiciens dont le foyer de création qui les regroupe est le sans
doute, trop oublié, JCOA Jazz Composers Orchestra auquel participent
également Carla Bley (qui y joue un rôle essentiel avec notamment
la grande aventure musicale « Escalator over the Hill »
qui regroupe tous ces acteurs), Cecil Taylor, Gato Barbieri, Andrew
Cyrille… qui se retrouveront dans diverses formations au cours de
leur carrière. C’est le cas dans les années 75/76/77 avec la
formation d’un quartet avec Keith Jarrett, Charlie Haden, Paul
Motian et Dewey Redman (« The Survivor’s Suite » 1976).
Parallèlement se forme le célèbre « Old et New Dreams »
que Michel Jules organisateur de Rouen Jazz Action depuis 1972 eut la
bonne idée d’inviter en 1980 (quatre ans après leur premier
enregistrement). Ecouter le saxophoniste Dewey Redman avec Don
Cherry, Charlie Haden et Eddie Blackwell me mit dans un état de
grande excitation. L’ombre d’Ornette Coleman planait bien entendu
dans l’esprit de tous les amateurs. Mais Redman, c’est Redman et
lui aussi jouait avec une puissance de jeu, une capacité
d’improvisation et d’audaces qui nous ravissaient. Toujours dans
cette vieille église rouennaise désaffectée, la salle Ste Croix
des Pelletiers (voir article Archie Shepp), la salle était comble ce
jour-là. Concert à 21h30, 35francs la place. On s’installe, ça
discute, toujours des derniers concerts, des disques achetés, on
parle d’Ornette, pour les novices on explique en long et en large
pourquoi Don Cherry et Charlie Haden sont des géants, et qui est
Blackwell, faisant désirer davantage à nos auditeurs le début du
concert. Ca ne démarre pas, l’impatience monte un peu, mais si le
public de 68 a quasiment dix ans de plus, il a encore des choses à
se raconter. Le batteur semble absent de la scène. L’organisateur,
un peu embarrassé, finit par expliquer que le batteur (dont on
connaissait les problèmes de santé) avait un retard de transport du
fait d’une dialyse pratiquée en Suisse. Le choix nous était donc
proposé d’attendre ou de laisser le trio commencer. Les réponses
furent confuses, Redman, Haden, Cherry tentèrent un démarrage. De
mémoire, je crois que nous avions fini par admettre d’attendre, la
tension n’en montant que de plus bel. Nous savions quel batteur
était Blackwell et il allait de toute façon arriver. Vers 23h,
tunique et coiffe africaines, Eddie Blackwell entre par le fond de la
salle, longe l’allée qui mène à la scène sous les longues
ovations du public. L’installation est rapide et c’est parti pour
un concert magnifique de bout en bout. Le son des soufflants,
magistral, emplit la salle, avec une basse et une batterie toujours
présentes. Haden livre un solo de toute beauté dans un « Lonely
Woman » ô combien émouvant. Don Cherry affiche sa sonorité
propre à lui. L’homme dont on a écouté tant de choses, joue là
sous nos yeux avec toujours la même générosité et sensibilité.
Haden discret, modeste tire de sa basse avec précision et efficacité
les sons qu’on lui connaît et qu’on reconnaît. L’équilibre
du groupe est sans failles. La présence du batteur est permanente et
le solo prend naturellement sa place. Roulements rapides, frappes
précises, un rythme s’installe, mais très vite un autre se
superpose, batterie ? percussion ? tam-tam ?,
mouvements complexes d’une grande rapidité, les bras semblent à
peine bouger. Redman reprend le thème avec les autres,
applaudissements à tout rompre adressés au batteur qui n’en
continue pas moins à jouer de toute son énergie, le solo se fond à
nouveau dans la musique du groupe qui de thème en thème mène
l’émotion à son comble. De quoi s’en souvenir plus de 30 ans
après ! Il était clair que j’allais, ainsi que mes amis de
l’époque, continuer à suivre le parcours de ces gars-là.
« Allô,
Patrice ! -Oui. -J’ai eu ton message pour Charlie Haden
- Oui, un copain me l’a dit ces jours-ci ». Une amie du
Havre, enseignante de musique, qui connaissait bien aussi les
concerts de Rouen Jazz Action se souvient. « J’ai l’album
du Liberation Music Orchestra. J’aimais bien passer à mes élèves
le duo qu’il a fait avec Escoudé. –Ah oui, ça s’appelle
« Gitane», pas facile à trouver. Haden a joué avec beaucoup
de monde. Un duo, il en a fait un aussi avec le pianiste René
Bottlang qu’on connaît bien ici à Nîmes. Tu te souviens ?
il y avait eu aussi un concert à Rouen, avec le quartet Redman, et
Don Cherry et Ed Blackwell en duo ? Quelle musique ! Don
avait toutes sortes d’instruments : percus, flûtes,
tambourins et il chantait. Et Blackwell, quel jeu subtil ! »
Oui, j’avais pu assister deux ans avant le concert du quartet à ce
mémorable duo qui était impressionnant et audacieux : une
batterie et une trompette en 1978. Le souvenir de cette soirée était
sans doute encore dans les mémoires lorsqu’on les retrouva avec le
quartet, le souvenir de ces moments aujourd’hui même est intact.
Redman
est mort, Blackwell est mort, Cherry est mort, Haden est mort…
« Charlie
Haden ! : merde ! »
4
Patrice
Goujon le 18 juillet 2014
(Ce
texte est écrit en toute simplicité, un peu à la hâte. Il ne sera
sans doute pas sans erreurs d’écritures. Espérons juste qu’il
donnera envie aux plus jeunes de s’intéresser à l’œuvre de
tous les musiciens cités car ils firent tous partie à leur manière
d’une grande famille qui a exprimé, par sa musique, de grands
espoirs pour l’humain tout en procurant à ceux qui ont eu la
chance de les entendre de forts moments d’émotion. Quant à ceux
qui ont connu cette période, ils retrouveront probablement, chacun à
leur façon, avec des souvenirs semblables, le parfum de cette
époque.)
Signalons
que l’album de Doudou Gouirand « Forgotten Tales » a
été réédité en CD par Musea Records.
Nous
publierons prochainement dans notre rubrique « critiques
d’époque » celles de « Symphony for Improvisers »
et d’ »Eternal Rythm ».
JAZZ
ET APARTHEID
La
disparition de Nelson Mandela doit réveiller de nombreux souvenirs
chez les amateurs de jazz qui ont connu (de loin) cette période de
l’Apartheid, encore plus chez ceux qui l’ont subie ou aussi chez
les plus jeunes qui s’y sont intéressés. On peut sans doute se
réjouir, sur le plan de l’évolution humaine du respect unanime
accordé à celui qui a passé la majeure partie de sa vie en prison,
considéré alors par la CIA comme un dangereux terroriste. Même
s’il y a sans doute beaucoup de « larmes de crocodiles »,
car à l’époque certaines banques et grandes sociétés
continuaient sans vergogne à mener leurs affaires, tout comme avec
les dictatures de l’Amérique du sud. Il y avait bien sûr des
manifestations en Europe et dans le monde liées au bouillonnement de
mai 68 en France, mais une grande majorité du monde n’était pour
autant émue ni par l’emprisonnement de Nelson Mandela, ni par le
sort réservé à la population noire étrangère dans son propre
pays.
Le
joug imposé à toute la population noire n’a pas épargné les
artistes, encore moins les musiciens de jazz, ni les artistes ou
écrivains blancs qui voulaient briser cette ségrégation
insupportable au quotidien. Miriam Makeba illustre sans doute le
mieux ce combat, contrainte à s’exiler aux Etats-Unis subissant
les affres de l’Apartheid et les douleurs de l’exil. Tout comme
son ex- compagnon Hugh Masekela (trompette, bugle) qui, vers ses 20
ans en 1961, a quitté l’Afrique du Sud pour les Etats-Unis. Il
composera « Soweto Blues » pleurant les massacres qui ont
suivi l’émeute de Soweto de 1976. Du côté blanc, c’est Johnny
Clegg, surnommé le « Zoulou blanc » qui connaîtra
arrestations et boycott de ses concerts pour son engagement pour
l’abolition de l’Apartheid. Dans ce contexte difficile, avec un
régime toutefois de plus en plus contesté, plusieurs musiciens vont
résister, le plus souvent contraints d’aller porter leur
témoignage, à l’aide de leur musique, à l’extérieur. Se
rapprochant des musiciens noirs américains avec lesquels il y avait
bien évidemment communauté de combat et qui eux-mêmes dans cette
période prônaient d’une certaine façon le retour aux racines
africaines, ces musiciens vont constituer un véritable courant de
jazz sud-africain. Le pianiste Dollar Brand (qui deviendra Abdullah
Ibrahim), classé « métis » par les lois de l’Apartheid,
en est le parfait exemple, collaborant avec des musiciens de renom
comme Gato Barbieri, Elvin Jones, Don Cherry, Archie Shepp… Dans
cette mouvance, apparaît aussi un pianiste blanc, né à Somerset
West, se considérant « citoyen du monde » : Chris
Mc Gregor. Il s’entoure d’amis musiciens noirs, la majorité du
groupe doit s’exiler à Londres. A ses côtés, des musiciens qui
marqueront l’histoire du jazz de cette période : le batteur
Louis Moholo, le contrebassiste Johnny Dyani, le sax Dudu Pukwana, le
trompettiste Mongezi Feza, le ténor Ronnie Beer. Avec cette bande de
« résistants » qui diffusent une musique à la fois
joyeuse, imprégnée des sonorités et rythmes africains, non sans
une certaine mélancolie, ponctuée par des cris de révolte, Chris
Mc Gregor crée une formation à géométrie variable : le
célèbre « Brotherhood of Breath » qui a ravi tous ceux
qui ont eu la chance de l’entendre . Tous ces musiciens, s’ils
ont bien entendu souffert de l’exil, ont sans doute tenu grâce à
la chaleur des rencontres musicales et humaines avec les frères
Black d’Amérique et à l’accueil souvent chaleureux du public en
Europe et ailleurs, profitant d’une liberté impossible au pays.
Mais n’oublions pas que beaucoup de musiciens n’ont pas pu
échapper au poids du régime de l’époque et ont vu leur talent,
voire leur carrière, bridé par un contexte étouffant. La fin de
l’Apartheid n’a pas non plus toujours apporté ce qui était
attendu. Plus récemment, le compositeur, arrangeur et instrumentiste
Zim Ngqawana qui avait mis en musique l’investiture de Nelson
Mandela, après avoir subi comme tous les autres le poids de
l’Apartheid et les difficultés de l’exil, décède en mai 2011,
victime à la fois d’un désespoir « post-Apartheid »
et plus concrètement de déficiences, semble-t-il, du système
hospitalier de la ville de Johannesbourg qu’il ne supportait plus.
Tous
ces musiciens ont forcément inscrit leur musique dans un combat qui
rejoignait naturellement celui des jazzmen des Etats-Unis . Avec des
styles, des émotions diverses, il y avait en commun l’aspiration à
un monde meilleur , plus humain, en tout cas débarrassé des
horreurs de l’Apartheid et de la stupidité de la ségrégation et
du racisme. Le jazz a donc encore fort à faire !
Nous
ne pouvons évidemment ici signaler tous les albums quasiment
historiques de la période que nous venons d’évoquer. Nous
tâcherons d’en citer quelques-uns prochainement dans notre
rubrique « critiques d’époque ».
Patrice
Goujon 08 décembre 2013 pour Le Jazz Est Là
Le
Jazz Est Là a fait La Java
Plusieurs
amis étaient à Paris le dimanche 21 avril à La Java pour l’hommage
rendu aux musiciens disparus ces derniers temps. L’initiateur de
cet après-midi était malheureusement absent pour des raisons de
santé, mais bien sûr tous les participants pensaient à lui. C’est
Margriet Naber (qui a longuement partagé sa vie avec John Tchicai)
qui a introduit la séance avec quelques mots et en musique en duo
avec le saxophoniste François Jeanneau. Puis des formations se sont
succédés jusqu’au soir dans une atmosphère très chaleureuse
avec de nombreux musiciens venus en toute simplicité pour des
retrouvailles marquées du souvenir partagé des amis disparus Ainsi,
on a pu entendre Michel Edelin, John Betsch, Peter Giron, Rasul
Siddik, Simon Goubert, Sophia Domanchich, Sylvain Cathala, Michel
Zenino, François Lemonnier, et beaucoup d’autres. On a aussi
retrouvé Margriet Naber et François Jeanneau aux côtés de Bernard
Santacruz à la contrebasse et Famoudou Don Moye à la batterie.
Chaque intervention musicale était marquée d’une forte émotion
car la présence de tous, musiciens comme public, avait bien là une
résonance toute particulière. Merci à Gérard Terronès qui malgré
ses difficultés de santé a maintenu cette initiative.
Jazz
à la Java, hommage à la vie
Le
Monde.fr | 23.04.2013 à 11h48
Par Francis
Marmande
Gérard
Terronès, infatigable inventeur de labels «indé» (Futura, Marge,
Impro,Jazz
Unité)
sous couvre-chef cordouan à bords plats. Un port de tête
inimitable. Des clubs comme s'il en pleuvait (du Blues
Jazz Museum
au Totem), des concerts ou festivals historiques –
au Centre culturel
Américain, au Palais des Glaces, à Massy, au Déjazet –, des
tournées d'artistes, comme si tout était possible. Car la carrière
de Gérard Terronès, épaulé par son épouse Odile et son fils
Eric, consacrée sans partage à l'avant-garde et à toutes les
possibilités desmusiques afro-américaines,
à tous les possibles de leurs dérivés, à toutes les possibilités
de l'improvisation et du rare, ne pose qu'une question: comment ça
tient? Comment ça dure? Comment dans un monde hostile, c'est là,
depuis 1965?
DEPUIS
1965, UNE PETITE BOUTIQUE DE DISQUES ET LA JOIE D'ENTREPRENDRE.
EN 2011, JAMAIS LASSÉ, TERRONÈS PROGRAMME UNE FOIS PAR MOIS À LA
JAVA LES CONCERTS QU'IL VEUT PROGRAMMER. LA
JAVA, 105, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE À PARIS 10E,
EST UN DANCING À PAILLETTES, BOULE À FACETTES ET FLONS-FLONS QUE
HANTENT ENCORE LES OMBRES D'EDITH PIAF, NÉE JUSTE UN PEU PLUS HAUT,
ET DJANGO REINHARDT, NÉ PAR LE HASARD DES ROUTES EN BELGIQUE.
C'EST DEVENU, COMME VOUS DIRIEZ,
UN LIEU D'«ÉVENTS». SOIT. OÙ TERRONÈS AURA-T-IL DÉNICHÉ
L'IDÉE DE REPRENDRE CE
POINT MYTHIQUE, UNE FOIS PAR MOIS? MYSTÈRE. SEUL, SON CHAPEAU
CORDOUAN À BORDS PLATS, TEL CELUI QU'ARBORAITLESTER YOUNG,
POURRAIT RÉPONDRE.
Toujours
est-il que le dimanche 21 avril à 16 heures, jusqu'à la fin de la
journée, il lui est venu l'idée baroque de célébrer
les disparitions de
musiciens qu'il avait aimés, produits, propulsés, tous morts sans
excès de tapage dans les derniers six mois : Jef
Gilson, Byard
Lancaster, Jacky
Samson, John
Tchicai,
Jean-François Canape, David S. Ware, Lol
Coxhill, Sean
Bergen, Ted
Curson, Yusef
Lateef,
et aussi bien, Maxim
Saury.
De Claude
Barthélémy
(guitare) à Sophia
Domancich (piano)
et Nelly
Pouget(sax),
le plateau aurait eu de quoi séduire n'importe quel éberlué des
innovations et des drôleries de la musique. Or Terronès n'a qu'un
lien aléatoire, voire cachottier, avec la publicité, la «promo»
et la «com ». Il n'est pas impossible que la discrétion de cette
conduite soit, au fil de ses insatiables aventures, ce qui le
maintienne en vie.
Très
très débridés
Des
dix-sept soli, trios (Michel Edelin), quintets (formidable Simon
Goubert ou
François Jeanneau avec Margriet
Naber, Bernardo
Santacruz, Don
Moye et Yolo
Thchicai),
isolons par pur choix et sans hauteur, des moments: le dialogue
insensé de Pauvros (guitariste très électrique) et Ramon
Lopez (percussions
de haut vol); le FranzK Trio; et Sylvain Guérineau (ténor) avec
Santacruz et Lopez.
Pauvros,
du haut de ses 2,02 mètres pour une petite soixantaine de kilos,
continue de veiller sur
un univers sonore que personne n'a jamais exploré à ce point,
passe encore, mais où pas grand monde ne s'aventurera plus, parce
que ce serait comme faire du
Pauvros. Guérineau, autre limonade: instituteur de la République,
il continue de se vouer à
la peinture et au sax ténor. Tous les musiciens de la capitale
connaissent son son incroyable, sa façon hallucinante, amoureuse,
amante, de traiter la
musique, mais il entretient à la «com» et à la «prod» le même
rapport bigleux que Terronès, bel hommage. Quant à FranzK Trio,
attention: il s'agit d'une chanteuse, une vocaliste
(Françoise-Franca
Cuomo)
en lien direct, d'inconscient à inconscient, avec Cyril
Trochu et Guillermo
Benavides.
Un des instants les plus déchirants de tous les temps.
Pourquoi
ces êtres humains, ces débrousseurs, ces pisteurs poïélitiques
irrepérables, ne sont pas célébrés – on s'en fiche –, mais
simplement donnés àentendre partout
et sous toutes les latitudes? Mystère. Ce n'est pas notre
affaire.Voir la
liste des musiciens présents à la Java – du pianiste Bobby Few à
qui vous voulez. Sans compter ceux,
Alain Pinsolle (accordéon), Jean Bordé (contrebasse), Christian
Lété (batterie), Frédéric Maintenant (piano), Eugénie Kuffler,
qui auront joué très très débridés. Pour la joie de jouer.
Répétons-le, la vie existe. Elle ne se sait pas toujours. Ah oui,
animateur de Jazz en Liberté sur Radio Libertaire, Gérard Terronès
est militant de la Fédération Anarchiste. Mais cela va sans dire.
Francis Marmande

JOHN
TCHICAI (1936-2012)
John
Tchicai, compositeur, saxophoniste et flûtiste est décédé le 8
octobre dernier à Perpignan suite à des complications liées à un
accident vasculaire cérébral. Au vu du manque de réaction de la
presse ,française en particulier, je souhaite évoquer à nouveau
auprès de tous nos contacts l’œuvre et la personnalité
exceptionnelles de ce musicien ayant eu l’occasion de le connaître
de près et d’apprécier sa créativité restée intacte ainsi que
sa personnalité généreuse:
Né
à Copenhague, il avait exploré la scène de jazz danoise et
nord-européenne, puis rejoint dans les années soixante la scène
new-yorkaise. Sa collaboration très étroite avec tous les plus
grands acteurs de l’avant-garde américaine de ces années-là le
fait souvent passer pour américain. Il était en fait afro-danois,
sa mère danoise et son père congolais. Toujours très présent sur
les scènes de Copenhague en particulier au célèbre «Café
Montmartre», il reçut une bourse à vie du ministère de la Culture
du Danemark. Mais les racines africaines ont toujours influencé son
inspiration. Il collabora longtemps avec les sud-africains Dudu
Pukwana et Johnny Dyani.
Dans
les années soixante on le trouve aux côtés de Cecil Taylor, Archie
Shepp, Albert Ayler, Don Cherry, Sunny Murray… Il participe à
l'enregistrement historique « Ascension» de John Coltrane.
Il
fonde le célèbre « New-York Art Quartet» avec le tromboniste
Roswell Rudd, le batteur Milford Graves et le contrebassiste Lewis
Worrell auquel participe le grand poète et combattant Leroi Jones
(Amiri Baraka), il est aussi dans le « New York Contemporary Five»,
formation elle aussi historique.
Impossible
de tout citer, tant l'œuvre est grande. John Tchicai était capable
de jouer magnifiquement en duo avec Pierre Dorge (album «BalI at
Louisiana» en hommage à un artiste du mouvement dadaïste) et tout
aussi bien avec une formation de près de trente musiciens(
«Afrodisiaca »). La musique des autres cultures était une
inspiration perpétuelle pour lui. Il prit également le temps
d'enseigner, de jouer dans les prisons, les universités, de
participer à une rencontre avec John Lennon (album « Life with
Lions»), de s'entourer de poètes, devenant parfois lui-même
récitant. Citons encore
quelques albums:
«Real
Tchicai» en trio avec le guitariste Pierre Dorge et le
contrebassiste Niels Henning Orsted Pederson,
« Witch'Scream » en 2004 à New-York avec Andrew Cyrille et Reggie
Workman, «John
Tchicai with Strings» en 2005 et enfin le magnifique «Coltrane in
Spring» en 2007. Sans oublier l’étonnant , très lyrique et
inventif «Anybody Home?» enregistré dans une grotte aux îles
Feroe où sa musique dialoguait avec les oiseaux et le bruit des
vagues.
A
76 ans, ce saxophoniste avait encore de nombreux projets en cours,
comme ce fut le cas tout au long de sa vie, projets d’écriture
musicale, de textes qu’il aimait réciter ou chanter, de concerts.
Le dernier en vue qui devait avoir lieu à Nîmes en septembre, qu’il
a évoqué lors de sa maladie, était
prévu avec son ami de longue date Famoudou Don Moye, batteur
de l’historique Art Ensemble de Chicago avec lequel il avait
enregistré en 1985 les «African Tapes».
Créateur
infatigable, d'une grande modestie, très attentif aux musiciens qui
l'entouraient, John Tchicai a toujours marqué ceux qui travaillaient
avec lui, ceux qui le côtoyaient par la sérénité, l'intelligence
et la grande humanité qui émanaient de sa personne.»
Patrice
Goujon Le Jazz Est Là le 15/10/2012

La
venue d’Archie Shepp au festival de Junas le 22 juillet est un vrai
bonheur pour tous les amateurs qui le connaissent depuis longtemps et
pour ceux qui le découvriront et qui viendront probablement
nombreux. Faisant partie de la première catégorie, Shepp ayant été
l’un des musiciens qui m’a d’emblée fortement marqué ,
l’envie était forte d’évoquer les différentes occasions que
j’ai eues d’être en quelque sorte un « supporter » comme
beaucoup d’autres admirateurs, car au-delà des critiques et
analyses de spécialistes, des interviews, des reportages dans les
magazines (qui présentent tous bien sûr un intérêt indéniable),
il reste que les amateurs, le public contribuent, à leur façon, à
la diffusion du jazz et à la renommée d’un musicien. Ecoutant
Archie Shepp depuis plus de quarante ans, ayant eu la chance de
suivre (en partie) son oeuvre au fur et à mesure qu’elle se
construisait, je veux livrer ici ce qu’ a été en quelque sorte «
mon histoire de Shepp » dans laquelle, ceux qui voudront bien la
lire trouveront - pour les plus anciens- des moments qu’ils ont dû
vivre de façon assez semblable (ayant chacun bien sûr une histoire
propre avec le jazz en général et la période dont nous allons
parler) et- pour le public plus récent- jeune ou pas ,quelques
repères qui permettront sans doute de mieux connaître un musicien
pour lequel il ne suffit pas de dire aujourd’hui que c’est un
grand. Je dirai parfois « nous », car cette passion du jazz et
admiration de Shepp, je la partageai avec bon nombre d’amis de ma
jeunesse et d’amateurs anonymes. Ce texte est évidemment écrit en
toute simplicité, il ne sera pas sans erreurs d’écriture ou de
maladresses, mais le but est surtout de faire partager
l’enthousiasme.
Mon histoire avec Shepp commence avec l’écoute
du disque de John Coltrane « Ascension » alors que j’étais
encore jeune lycéen. Coltrane était entré à la maison quelques
années avant avec le magnifique « Olé » qui fit grincer des dents
les parents ! « Ascension » qui sortit en 1965 arriva un peu plus
tard en France, encore plus tard dans une ville de Normandie. En
effet, à l’époque, les disques arrivaient au compte-goutte,
encore fallait-il qu’il y ait un disquaire qui s’intéresse à un
jazz parfois maudit par certains. Un seul titre pour cet album qui
était une longue improvisation regroupant tous les musiciens qui
allaient marquer la nouvelle ère et dont je suivrai la carrière
avec passion. Ne citons que les saxophonistes : Pharoah Sanders,
Marion Brown, John Tchicai (invité récemment à trois reprises à
Nîmes pour notre plus grand bonheur avec Le Jazz Est Là) et …
Archie Shepp. Il était donc dans la liste des nouveaux venus et il
fallait d’urgence avoir quelque chose d’autre sous son nom ainsi
que pour chaque musicien du disque, car s’ils jouaient avec
Coltrane, ils étaient forcément grands et l’avenir nous le
confirma ! L’album « Newthing at Newport » (chez Impulse en 1965)
tomba à pic, consacrant une face au quartet Coltrane et l’autre à
Shepp avec des musiciens que je découvrais : Barre Phillips, Bobby
Hutcherson, Joe Chambers. La pochette du disque était lue et relue,
mettant ma connaissance de l’anglais à rude épreuve, mais les
titres et noms des musiciens étaient connus par coeur. Le terme New
Thing du titre de l’album fut la nouvelle expression utilisée, à
la place de free jazz, trop souvent mal interprétée ou mal
comprise, voire l’occasion de critiques caricaturales, alors
qu’Ornette Coleman avait lui aussi enregistré quelques années
auparavant l’album historique intitulé « Free Jazz » avec un
double quartet .C’est donc dans ce « New Thing at Newport »
qu’était enregistré le célèbre « Matin des Noirs » écouté
et réécouté au point d’avoir le thème dans la tête, quasiment
note par note, malgré ma méconnaissance de la musique,
techniquement parlant. C’est à ce moment que le son très
personnel d’Archie
Shepp me marqua définitivement. L’engagement
d’Archie Shepp était aussi déjà là et cela ne gâchait rien
puisque, l’amateur de jazz que j’étais, s’intéressait comme
beaucoup d’autres à ce qui se passait du côté du mouvement noir
aux Etats-Unis.
Cela dit, faute d’autres disques disponibles
dans ma ville, la soif d’en savoir plus était, à l’époque,
satisfaite par la lecture assidue de Jazz-Hot ou Jazz Magazine, pour
suivre l’actualité, lisant les critiques d’albums qui tardaient
à venir et rageant de ne pouvoir assister à certains concerts qui
commençaient à avoir lieu en France. Ce fut alors l’occasion de
mieux comprendre quel itinéraire avaient suivi ces musiciens. Je
découvris qu’Archie Shepp, arrivant à New-York, avait enregistré
avec un certain Cecil Taylor, pianiste exceptionnel, en 1960. Suivent
rapidement les noms de Ted Curson (trompettiste qui collabora
longtemps avec Charlie Mingus), Roswell Rudd (tromboniste qui suivra
Shepp de longues années), Sunny Murray et Henry Grimes tous présents
dans The Cecil Taylor Unit qu’on écoute encore aujourd’hui avec
plaisir et qui est toujours marqué d’une grande modernité. Il
était clair que tous ces musiciens étaient importants et je ne
pouvais coller à leur actualité qu’au travers des revues et des
annonces de disques, achetant certains d’entre eux beaucoup plus
tard, n’ayant pas toujours les moyens, ni la possibilité de les
trouver. Combien de fois ai-je regretté de me trouver à acheter une
réédition en Cd de disques que je n’avais pu acheter à l’époque
au moment de leur sortie ! Mais, retrouver tout, ravive la mémoire.
Ce fut le cas pour Fire Music (album Impulse mars 65), dans lequel se
trouve le titre « Malcom, Malcom, semper Malcom » qui me bouleversa
et auquel participe Marion Brown qui était dans l’ « Ascension »
du début, puis « Four for Trane » (août 1964) qui est présenté
par l’écrivain et poète Le Roi Jones (Amiri Baraka - auteur de
l’ouvrage « Le Peuple du Blues ») constamment présent et engagé
aux côtés de ces nouveaux maîtres du jazz. En janvier 1964 sort
l’album « Consequences » qui marque la collaboration entre Archie
Shepp et Bill Dixon disparu l’an passé. John Tchicai, Don Cherry
participent à l’enregistrement. L’un et l’autre par la suite
marqueront à leur façon l’histoire de ce jazz nouveau. A propos
de cet album Le Roi Jones écrivait : « Shepp combine la fureur de
Coltrane et l’accent solide, le génie du blues presque intemporel
d’un Ben Webster ». Sur la pochette du disque BYG chroniqué par
Philippe Carles (Jazz-Magazine), on pouvait lire les propos de Bill
Dixon : « Et si la musique comme tous les autres arts, reflète
jusqu’à un certain point son époque, comment peut-elle s’empêcher
de refléter ce qu’elle constate ? » Cette musique, à l’évidence,
était directement liée aux convulsions de la société, aux luttes
diverses dans le monde, à commencer bien sûr par celle du combat
pour l’égalité des droits noirs/blancs aux Etats-Unis. Au
passage, contrairement à la présentation des CD d’aujourd’hui,
les vinyls nous invitaient à une lecture studieuse des textes où là
aussi nous apprenions beaucoup sur chaque musicien, chaque
composition et sur l’évolution générale du courant musical. Les
pochettes qui s’ouvraient en deux parties avec texte et photos,
avec aussi des couvertures célèbres, étaient un vrai régal. C’est
là aussi que je piochais de nombreuses informations qui aiguisaient
souvent mon désir d’en savoir plus. Merci à ceux qui ont
chroniqué avec bonheur et sincérité des albums qui n’étaient
pas du goût de tous.
Abonné à Jazz-Hot en 1969 (année de mon
baccalauréat), j’y trouvai avec ravissement en couverture tous les
grands noms qui me fascinaient. D’une grande simplicité, liée aux
moyens de l’époque, le magazine nous livrait quelques publicités
bienvenues présentant les nouveautés des catalogues Impulse, BYG
qui, pour la majorité, allaient devenir des enregistrements
historiques et que j’attendais avec impatience dans les bacs de mon
disquaire local. « Kulu Se Mama », « Coltrane at the Village
Vanguard », « Tauhid » (Pharoah
Sanders), et déjà les Shepp :
« Mama Too Tight » (1966), « Magic of Juju » (1967). Albums que
je ne tardai pas à me procurer. C’est aussi dans les magazines que
je trouvai toute l’actualité qui en grande partie se déroulait à
Paris, mais parfois aussi dans d’autres régions. La lecture des
comptes-rendus de concerts prenait alors un relief tout particulier.
Ce n’est qu’à travers cette lecture que je savais ce qui se
passait dans le club le plus free de Paris : « Le Chat qui Pêche »
que je connaîtrai plus tard.
Le mouvement de 1968 tout frais
encore et dont j’avais connu le bouillonnement en tant que lycéen,
nous avait porté à enrager contre la guerre au Vietnam, contre
l’Apartheid et à nous passionner pour les combats comme celui de
Guevara ou celui de Martin Luther King, puis des Black Panthers. Nous
étions prêts à partager tout cela avec les artistes noirs qui, au
travers de la musique, poussaient leur cri.
De ce point de vue,
l’été 1969 ancra cette orientation lors du Panafrican Festival à
Alger où se retrouvèrent tous les « leaders » (dont Archie Shepp
bien sûr) du courant d’avant-garde, mêlés aux écrivains, poètes
et théoriciens du mouvement noir américain ainsi qu’aux musiciens
de plusieurs pays d’Afrique, les jazzmen marquant leur retour aux
sources. J’entends alors parler de Ted Joans,(interviewé dans le
N°252 de Jazz-Hot en 1969 –le griot surréaliste-), Eldridge
Cleaver et bien d’autres. Le numéro 253 de septembre 1969 me fit
rêver. La couverture présente, en tenue d’été, Sunny Murray,
Grachan Moncur III et Archie Shepp en train de discuter. A
l’intérieur : photos des nuits d’Alger par Philippe Gras et
Horace, Shepp trônant dans une grande djellabah blanche entouré de
deux joueurs de derbouka du Maghreb. De cette période, le label BYG
laissera des traces discographiques. Venant de passer mon Bac,
j’avais, cet été là, effectué mon premier boulot d’étudiant
aux PTT (Postes-Téléphone-Télégraphe, qui existaient encore) qui
me rapporta 800Frs. Pas si mal pour une première paye, compte-tenu
que le mouvement ouvrier avait réclamé un salaire minimum de 1000
Frs en 68 ! J’allai illico en dépenser le quart chez mon
disquaire, me procurant en particulier le célèbre « Poem for
Malcom », « Yasmina a Black Woman » de Shepp, mais comme il joue
aussi dans « Ketchaoua » de Clifford Thornton (trompettiste) :
j’achète, au passage « Hommage to Africa » de Sunny Murray :
j’achète aussi et bien sûr l’album même « Pan African
festival » et ainsi de suite. Jusqu’à présent, l’écoute de
ces disques (même s’ils ont été pour certains réalisés un peu
hâtivement) me procure toujours une grande émotion ravivant sans
doute la mémoire des écoutes répétées que j’en fis à l’âge18
ans ! Philippe Carles disait de Shepp à ce moment : « C’est un
révolutionnaire, partisan d’une musique violente et subversive. Ce
qui compte pour lui : tous les chapitres de la musique
afro-américaine ». Oui, et tout cela nous ramenait au blues, à
Charlie Parker, il jouait radicalement mais interprétait
parallèlement magnifiquement « Body and Soul », se souvenait
d’Ellington avec « Prelude to a Kiss » et de tant d’autres
choses qui ne pouvaient que ravir l’amateur que j’étais. Et
puis, il y avait ce retour vers l’Afrique, autre sujet de passion.
Les musiciens arboraient alors des tenues africaines, les titres
mêmes des albums s’inspiraient des langues africaines ou de lieux
découverts par eux. Parallèlement fit irruption un courant de
jazzmen d’Afrique du Sud dont les grands représentants furent
Dollar Brand (Abdullah Ibrahim), Chris Mc Gregor, Johnny Dyani, Dudu
Pukwana et bien d’autres. Au milieu de ce bouillonnement musical et
culturel, les amateurs comme moi, et il y en avait, considérèrent
déjà Shepp comme un grand !
D’autres albums suivirent chez
America (moins connus peut-être et plus rares) qui confirmèrent ce
qui vient d’être dit : « Black Gipsy » (nov 69) avec Chicago
Beau (vocal), Julio Finn (harmonica) et un violoniste qui fera parler
de lui plus tard : Leroy Jenkins, Dave Burrell
au piano compagnon
de route de Shepp… Sur la pochette, on trouve en français le texte
de Chicago Beauchamp : « Dans cet album « Black Gipsy », sont
réunis quelques-uns des plus grands musiciens noirs de ce siècle.
Dans le premier titre qui porte le même nom que l’album, nous
avons essayé d’exprimer l’éthique de vie du peuple noir et de
transmettre ce sentiment à tous ceux qui l’écouteront. En
d’autres termes nous espérons que chaque artiste ou, tout
simplement, tous ceux qui aiment l’art et la musique pourront
ressentir cette liberté du Gitan et aimer ce que nous essayons de
transmettre dans cette musique. Je tiens à remercier tout
particulièrement Clifford Thornton et Archie Shepp qui ont très
largement contribué à la beauté de ce disque ». Suivra en déc 69
(décidément année très prolifique, et ce n’est pas pour rien),
« The Lowlands », avec à peu près la même équipe, sidérante,
qui accueille Anthony Braxton et le « vieux » Philly Joe Jones
(déjà présent dans « Yasmina a Black Woman »). Shepp est aussi
au piano qu’il pratiquera magnifiquement en d’autres
circonstances. Chicago Beauchamp écrit à nouveau: « The Lowlands
is a musical portrait of live in the black ghettos and southern black
communities ». Ma collection s’agrandissait. Dès qu’on parlait
jazz, je citais Shepp, tout le monde savait à quel point je
l’admirais (parmi tant d’autres qui jouaient avec lui), je
prêtais des disques, je lassais un peu mes parents mais ils savaient
qui c’était, des copains partageaient ce bonheur…. Néanmoins,
je n’avais encore jamais assisté à un concert de mon saxophoniste
quasi préféré. Et les concerts dans ma ville natale manquaient
encore cruellement.
L’été 1970, c’était décidé, au regard
de la programmation d’Antibes/Juan-les-Pins et de St Paul de Vence
, j’allais pour la première fois « descendre » dans le sud bien
inconnu pour moi et pour lequel il fallait encore bien à cette
époque 12 à 14h pour un train de nuit pour aller de Rouen à Nice.
Accueilli par la famille d’un copain de lycée à Nice, je me
débrouillai pour aller pour la première fois de ma vie au célèbre
festival d’Antibes qui programma une soirée en deux parties : Stan
Getz et Archie Shepp. Une partie du public était venue pour Stan
Getz, l’autre pour Archie. Notre radicalisme, sans doute un peu
outrancier, nous avait empêchés d’apprécier à sa juste valeur
le talent de Getz. Mais, nous étions là pour Shepp. Antibes était
déjà un peu guindé et cher. Le public Shepp, surtout des jeunes,
avait bien sûr acheté les places les moins chères. Il suffisait
d’attendre le début, pour que d’un même élan, les « fans »
enjambent les barrières pour atteindre les places du parterre, les
plus chères, les plus vides ! Shepp, avec coiffe et tenue africaine,
fit une entrée ovationnée au sein du « Full Moon Ensemble » qui,
je ne l’apprendrai que plus tard, sera enregistré toujours par
BYG. Je me souviens de Shepp, de son entrée en scène, du son que
j’entendais enfin en direct, de l’ambiance dans la pinède,
c’était mon premier concert Shepp. Il y avait, entre autres, le
trompettiste Cifford Thornton disparu trop tôt, le regretté Beb
Guérin l’un des français, contrebassiste, le plus engagé auprès
des jazzmen américains venus à Paris qui enregistra également avec
Sunny Murray, Alan Shorter et le batteur Claude Delcloo qui sera en
partie à l’origine des albums BYG de 1969. Les jours suivants
m’attendaient Albert Ayler et Sun Ra à la Fondation Maeght
(concerts me marquant pour toujours, sur lesquels je reviendrai à
une autre occasion). Mais ce qui resta particulièrement gravé dans
ma mémoire, au-delà du concert bien sûr, eut lieu après le
concert. Je n’avais rien prévu pour rentrer à Nice et je dus
flâner dans Juan-les-Pins. Ce qui ne manquait pas de charme puisque
je découvris l’activité nocturne tardive du sud à laquelle
n’était pas habitué un jeune normand. Mais pour moi, festival
signifiait qu’il devait y avoir quelque chose après le concert,
j’avais lu cela de nombreuses fois dans les comptes-rendus. Alors
!! En effet, je finis par trouver un lieu où se produisait un
pianiste. Ce n’est que plus tard que je compris qu’il se passait
même quelque chose d’important. Entrant dans le bar-club, je
trouve le pianiste (dont je connaissais le nom
- toujours la
lecture des revues-) : Siegfried Kessler. Pas trop de monde, je
m’assois donc le plus près possible, scotché au piano, « Siggy »
à son scotch. Ravissement total. Siegfried Kessler à Antibes ! Je
savais que Gérard Terronès (producteur du label Futura-Records) qui
l’avait vite repéré, avait réalisé son premier album (toujours
disponible d’ailleurs) avec Barre Phillips (le contrebassiste de
New Thing at Newport) et Steve Mc Call . Je ne quitte pas des yeux le
pianiste, je bois ses notes, il continue ses scotchs et je suis
décidé à rester jusqu’au bout persuadé que Shepp allait venir.
C’est ce qui arriva. Mon émotion fut telle que je n’ai jamais
oublié cette scène. Shepp s’accoude au comptoir et observe avec
attention les évolutions du pianiste. Sans doute trop timide à
l’époque, je n’ose pas l’approcher, lui dire un mot comme je
pourrais le faire aujourd’hui. Je suis en effet impressionné :
Kessler est sur ma gauche au piano, Shepp à droite au comptoir, mes
regards vont à présent de l’un à l’autre. Archie va-t-il
prendre son sax ? Je resterai jusqu’à la fin de la soirée. Heure
inconnue. Sûrement très tard. Belle soirée, mais un peu déçu,
Shepp n’a pas joué. C’est plus tard que j’apprendrai dans un
article qu’en fait, Shepp écoutait Siggy pour la première fois. !
Ils joueront plus de dix ans ensemble quelques années plus tard.
J’ai retrouvé en m’installant à Nîmes vers 2002, celui qu’on
appelait « Siggy » oscillant entre voyages en mer et ballades
musicales dans quelques lieux de la région. Il se souvenait très
bien d’Antibes et du reste. Nous l’avons perdu. Ne manquez pas la
musique de celui qui se plaisait à mêler à ses improvisations les
pièces des grands classiques qui l’avaient marqué et avec
lesquelles il jouait. C’est encore Gérard Terronès (jouant un
rôle primordial dans la diffusion de la musique d’Archie Shepp en
France) qui réalisa plusieurs enregistrements de cette période avec
lui : « Invitation » dans lequel Shepp joue sur deux thèmes en
1979, puis le Archie Shepp « Parisian Concert » avec Cameron Brown
(contrebasse) et Clifford Jarvis (batterie) en 1977, Archie Shepp
quintet « Tribute to Charlie Parker » en 1979, et la même année
Archie Shepp quartet « Round About Midnight » dans lequel on trouve
le titre « Blues for Brother George Jackson » leader des Black
Panthers, tué en août 1971 dans la cour de la prison de San Quentin
, ce titre marquant la fidélité d’Archie Shepp à son engagement
des premières années.
Suivront d’autres albums marquant les
collaborations diverses de Shepp qu’il est impossible de citer
toutes. Shepp tenait désormais une place de choix dans ma
discothèque à côté de Coltrane, de Pharoah Sanders, Marion Brown,
Sunny Murray, Sun Ra, Albert Ayler, Bobby Few, John Tchicai et tous
les autres. Cela dit, pour un grand amateur de Shepp, les concerts
manquaient toujours. Ce fut Rouen Jazz Action (dirigé -et
toujours jusqu’à présent- par Michel Jules) qui m’offrira les
plus belles occasions de l’entendre. Cette association, dans une
mairie plutôt conservatrice, organisait, contre vents et marées,
des concerts avec les plus grands représentants de
l’avant-garde.
Les
premiers concerts eurent lieu dans une ancienne église désaffectée,
imbriquée entre de vieilles maisons au cœur du vieux Rouen
(la Salle Ste Croix des Pelletiers) qui après avoir été un
entrepôt et chai à vin, était devenue un lieu de spectacle et de
conférences dont le décor surprenait souvent les musiciens qui sur
scène ne pouvaient s’empêcher en jouant d’observer les plafonds
et colonnades au-dessus de leur tête. C’est là que se produisit,
le 21 janvier 1976, Archie Shepp, que nous attendions, nombreux,
entouré de Dave Burrell au piano, Charles Greenlee au trombone,
Beaver Harris à la batterie et Cameron Brown à la
contrebasse.
Quelle formation ! Je les
connaissais tous par les lectures, les pochettes, les disques
précédents. Salle comble, beaucoup d’étudiants. La salle était
« équipée » de vieux sièges en bois, genre cinéma d’autrefois.
Peu importe, on pouvait s’asseoir par terre pour être dans les
premiers rangs sur un sol souvent poussiéreux, d’autres
préféraient s’accrocher aux chapiteaux des piliers, interdit ou
pas, ça fumait pas mal dans les coins. Entrée des musiciens
ovationnée et c’était parti pour deux bonnes heures. Le son
n’était pas toujours au top dans ce lieu, mais cela ne nous
dérangeait pas, ça jouait, fort, rapide, les thèmes s’enchaînent
sans répit, ça crie, ça chante, « Uhuru » ! « Mama Rose » ! «
Freedom » ! « Revolution » ! Le public réagit, applaudit, siffle
et crie sa joie, véritable partage de ce que les musiciens nous
envoient au travers de la musique. Les musiciens sentaient notre
adhésion et n’en jouaient que de plus belle. La vague américaine
déferlait sur un public européen qui n’attendait que cela.
Beaucoup de jazzmen américains s’installeront d’ailleurs
durablement en Europe et en particulier en France. Ce que nous étions
auparavant un peu condamnés à suivre de loin, arrivait chez nous.
Les détracteurs de ce courant devaient faire face à un rempart
sévère de partisans acharnés ! En octobre 1981, Rouen Jazz
Action reçut à nouveau Shepp en quintet . L’ambiance
ne change pas, Shepp est toujours bon, il garde la même puissance de
jeu, tradition enrobée de free ou free bardé de blues et de
swing.
A partir de là, je ne manquerai pas les occasions de
concerts et les enregistrements innombrables. Dans le désordre :
rencontres avec de prestigieux pianistes tels Mal Waldron (peu de
temps avant sa disparition), Tchangodaï, Horace Parlan, Dollar Brand
; avec des voix comme Abbey Lincoln « Painted Lady » ou « Archie
Shepp et Jeanne Lee » dont les titres évoquent bien la traversée
du saxophoniste de toute l’histoire du jazz : « Sophisticated Lady
», « Blue Monk » , « Tune for Shepp » dédicacé à Sun Ra et le
toujours présent « Mama Rose » que Shepp n’abandonnera jamais,
pour notre plus grand bonheur ! Voix aussi de Joe Lee Wilson comme
dans « Attica Blues Big Band ». Il retrouve Sunny Murray et Richard
Davis « St Louis Blues », les amis d’au moins 40 ans : Roswell
Rudd, Andrew Cyrille, Reggie Workman, Gracham Moncur III et Amiri
Baraka (Le Roi Jones) dans « Live in New York » en 2001 affichant
tous une superbe énergie et le plaisir évident des retrouvailles.
La discographie est immense à laquelle il faut ajouter le propre
label de Shepp « Archie Ball » qui a produit par exemple « Gemini
» avec encore d’autres vieux amis : Steve Mc Craven (batterie),
Wayne Dockery (contrebasse) et Tom Mc Clung actuel pianiste régulier
du groupe qui se produit depuis plusieurs années. Une de mes très
récentes flâneries dans « les Jeudis de Nîmes », alors que je
travaillais à ce texte, m’a amené à fouiller dans un bac de
disques. Je suis tombé sur un album du label Steeple Chase de 1982 …
Archie Shepp avec le pianiste Jasper Van’t Hof. Titre ??? Je vous
le donne en mille : « Mama Rose » !!! La pochette à elle seule
mérite l’achat : portrait de Shepp, chapeau de paille, pipe à la
bouche, pipe qu’il arborait déjà sur la pochette de « Four for
Trane ». Sur un fond blanc, écrit en gros « Mama Rose » qui
rappelons-le est un hommage à sa grand-mère qui connut les
humiliations de l’esclavage. Ce titre apparaît fidèlement et
régulièrement depuis le début de sa création, à chaque fois
émouvant.
A coup sûr, comme lors de sa venue précédente à
Junas, Archie probablement jouera, récitera, chantera, criera «
Mama Rose » (le 22 juillet 2011) avec Tom Mc Clung au piano et une
formation qui prouvera que le lien avec l’Afrique, les racines, n’a
jamais été coupé. Plus de quarante après l’écoute du « Matin
des Noirs », la « New Thing » sera encore là. Il y aura le
souffle de Shepp, mais à travers lui, celui de tous ceux (pour
beaucoup disparus aujourd’hui) qui auront oeuvré ensemble, pour
certains dans des conditions difficiles, à façonner ce courant
musical qui permettait déjà à Philippe Carles et JL Comoli
d’écrire dans
la préface de l’ouvrage « Free Jazz et Black
Power » en 1971 : « Qu’y a-t-il dans l’amour du jazz ? La
beauté, l’émotion, la nostalgie, l’excitation, la jeunesse, la
révolte, tout cela sans doute. Mais d’abord, le goût des chemins
nouveaux, le vif désir de l’inouï ».
Patrice Goujon président
de l’Association Le Jazz Est Là - Nîmes
15 juillet 2011
Mail
: lejazz.estla@laposte.net
























